
Fonds
social européen
Action
Equal :
«Apprendre
à apprendre pour
s’insérer ou se professionnaliser»
Etat des
lieux
Décembre 2002
Action
Equal :
«Apprendre
à apprendre pour
s’insérer ou se professionnaliser»
Etat des
lieux
Décembre
2002
Travail coordonné par Jean
Vanderspelden
avec l’appui de Giselle Féral,
et les apports de :
Burguet Claudine,
Houssier Patrick,
Tétart Michel,
& Yatchinovsky Arlette.
Tous les extraits de sites Internet, d’articles, de livres, d’études ou
d’outils ont été cités.
Sommaire
Préambule et rappels p 06
I) Apprendre à apprendre, en général
A) Les
territoires (travail
d’exploration sur Internet) p
07
- Apprendre à apprendre à l’école
et au collège (opération : la main à la pâte)
- Apprendre à apprendre au
lycée : les TPE (www.eduscol.education.fr/D0050/default.htm)
-
Apprendre à apprendre dans le réseau des APP : «Apprendre à s’autoformer» :
APP de Tarbes – «Gestion mentale» : APP du Baugeois et APP d’Angers –
«Stratégies d’apprentissage et interventions personnalisées en pédagogie
clinique» – Catherine Darriet de l’APP de Bayonne.
-
Apprendre à apprendre à l’université (université de Montréal et université de Lille 1 -
laboratoire TRIGONE)
- Apprendre à apprendre en
entreprise
B) Les concepts & références (travail
d’exploration sur Internet) p 20
-
Approche : «éducabilité cognitive»
o
Site de François
Muller : repères sur l’Educabilité cognitive PEI, PNL, Gestion Mentale et
Analyse transactionnelle,
o
Les logiciels de
remédiation cognitive : ex québécois,
o
Les pédagogies de
l’intelligence - Daniel Calin
http://daniel.calin.free.fr/biblio/penser.html
o
Livre «Pratiques
nouvelles en éducation & formation» L’éducabilité cognitive» -
collectif dirigé par M Sorel - L’Harmattan – 1994
o
Bibliographie en
ligne : «Remédiation» de l’ERAP
http://perso.wanadoo.fr/erap/fiches/list_rem.htm (lien obsolète)
-
Approche : accompagnement : «Histoire de vie» et «Autoformation»
o
Présentation des bases
de «Histoire de vie» - Références : «Le bilan personnel et
professionnel» - A Yatchinovsky & P Michard & «Histoire de vie» - P
Michard et A Yatchinovsky - ESF éditeur
o
Article «L’autoformation
accompagnée en APP ou les sept piliers revisités. – les APP ou l’autoformation accompagnée en
actes». Philippe Carré -
L’harmattan 2002
o
Bibliographie en
ligne : La galaxie de
l’autoformation Univ de Nantes
http://www.fc.univ-nantes.fr/PAGES/autoformation/menuAutoformation.html
C) Le
changement en formation p 28
D) Les outils & méthodes
pour apprendre à apprendre p 31
ACIM
ACTIVOLOG
ARL
AXIOS
Cube de Mialet
ORPHEE
TANAGRA
II) Apprendre à apprendre et le multimédia
2.A) Outils &
ressources : base «ressources» Algora
1) Ressources :
sciences de l’éducation p 38
2) Ressources :
raisonnement logique p
42
3) Ressources :
développement personnel p
46
4) Vie quotidienne et histoires de vie p 47
2.B) Outils &
ressources : la Boîte à Outils Multimédias
0)
Extrait de l’introduction de la BOM p
52
1)
Rubrique : BILan (BIL) p
53
2)
Rubrique : LanGage et logiquE (LGE)
3)
Rubrique : Culture Générale &
scientifique (CGS)
4)
Rubrique : Culture Technique et
Professionnelle (CTP)
5)
Rubrique : Outils du FormaTeurs (OFT)
6) Rubrique : Réseaux
et Ressources (RES)
7) bibliographies en
ligne : Apprentissage,
multimédia et TIC
http://www.mipplus.org/biblio_app&tic
8) Extrait de la fiche BOM
sur « Apprendre, comment ça marche ?» CSI
III) Premiers résultats p 57
3.1) «Apprendre à
apprendre» : approche neuve et plurielle
3.2) Quelques définitions
sur «apprendre à apprendre»
3.3) «Apprendre à
apprendre» vu par les membres du projet
3.4) Mots-clés ou incontournables sur «apprendre à apprendre»
3.5) «Apprendre à
apprendre» et les outils multimédias
IV) Le questionnaire p 64
Equal :
«Apprendre à apprendre pour s’insérer»
Etat
des lieux
Quelles définitions, quelles pistes, quels contextes ?
Quelles pratiques, quels outils, quelles démarches ?
è Préambule
et rappels
- Objectif du projet :
construire un outil multimédia ou une démarche intégrant le multimédia pour
favoriser le développement des pratiques de formation des adultes liées à «Apprendre
à apprendre». Cette action EQUAL comporte plusieurs phases. La première phase
repose sur trois étapes suivantes :
1er étape du projet :
- établir un état des lieux. (document en cours finalisé)
2ème étape du projet :
- construire un questionnaire pour recueillir l’avis des formateurs
(voir en
fin de document)
3ème étape :
-
à partir de l’exploitation de cet état des lieux, d’une
part, et de l’exploitation des résultats de l’enquête, d’autre part, définir
une piste de travail et ses modalités de mise en œuvre.
- Méthodologie de cet état des
lieux (étape 1 du projet)
* partir d’un terrain d’investigation large et
pluriel pour aller vers la formation des adultes en général, puis vers la
formation des adultes et le multimédia pédagogique. Tous les textes inscrits dans une
police de caractère de petite taille sont extraits, soit de sites Internet,
soit d’articles cités. Tous les
autres textes ont été rédigés par l’un des membres du projet.
* valider et conforter collectivement ce repérage.
- But : asseoir le projet pour lancer les deux autres étapes sur
une réflexion intégrant les logiques, les pratiques et les demandes de terrain.
I) Apprendre à apprendre, en général
A) Les territoires
***
Apprendre à apprendre à l’école
1)
Extrait du site http://www.peep.asso.fr/henri-dunant/novembre.htm
«Travail personnel : à chacun sa
méthode
"Apprendre une leçon, ça ne
se trouve pas dans les chromosomes et ça n'arrive pas par l'opération du
Saint-Esprit" rappelait récemment Philippe Meirieu, professeur des
sciences de l'éducation de Lyon II. Or, selon une enquête de la Direction de
l'évaluation et de la prospective, menée récemment dans une trentaine de
classes de CE2, rares sont les enseignants qui apprennent aux élèves à
apprendre. Deux maîtres observés sur trois donnent une leçon à mémoriser sans
expliquer aux élèves comment s'y prendre. Ni quel est l'intérêt de leurs
exigences.
Une carence que l'Education
nationale tente de pallier par la mise en place de structures - les études
dirigées en primaire et au collège, les modules en seconde et en première, le
tutorat à l'université - dont l'un des principaux objectifs est de faire
acquérir aux élèves des méthodes d'apprentissage (lire pages 22-23). Et, par
ailleurs, les parents aussi peuvent aider leurs enfants à apprendre à
apprendre. Il n'y a pas de méthode miracle pour apprendre à apprendre. Pour
l'enfant, l'enjeu de ce point de vue est de conjuguer personnalité et
efficacité, de mieux s'organiser en se connaissant mieux. Dès lors, les parents
ont un rôle essentiel, d'observation et de dialogue, pour aider leur enfant à
gérer son temps, sa charge de travail et à trouver les méthodes qui lui
permettront d'être performant.
Les travaux des scientifiques sont
formels : aucun enfant ne se développe de la même manière. Pour l'un des
pédagogues les plus écoutés en France, Antoine de La Garanderie,
directeur de recherche à l'université de Lyon 2, il existe deux tendances parmi
les élèves : ceux qui ont une mémoire visuelle et ceux qui ont une mémoire
auditive. Les premiers "photographient" ce qu'ils vont apprendre.
Pour eux, un croquis, une carte, un schéma valent tous les discours. Les
seconds apprennent plus facilement en répétant à voix haute ou en se parlant à
voix basse. Le psychologue
américain Kolb, lui, répertorie quatre styles d'apprentissage :
en expérimentant le savoir, en le théorisant, en l'observant attentivement ou
en en faisant le prétexte d'une création. Quant au psychologue canadien Hill, il
dénombre jusqu'à 157 variables différenciant chaque personne dans sa façon
d'apprendre ! En fonction de l'environnement, des émotions, mais aussi des
données sociologiques et psychologiques.
Si les parents n'ont pas besoin de
se plonger dans ces différentes approches pour aider leurs enfants à acquérir
des méthodes de travail personnel, ils peuvent néanmoins en tirer une leçon :
il n'existe pas de recette miracle pour apprendre à apprendre. Mieux vaut donc
commencer par observer et écouter ses enfants, afin de dégager avec eux les
conditions et les méthodes d'apprentissage qui leur seront les plus
appropriées. Ceci en tenant compte, non seulement des impératifs liés au
travail à la maison, mais aussi, bien sûr, des programmes et méthodes du (des)
enseignant(s), sans oublier les autres moments d'apprentissage personnel que
sont les études "dirigées", "surveillées" et autres
"modules" désormais proposés de l'école au lycée.
Apprendre demande du temps : celui
de faire des erreurs et de répéter les gestes sans faute. Certains enfants en
ont davantage besoin que d'autres. Ou l'utilisent différemment. L'important est
que chacun trouve son rythme, et apprenne à gérer ce précieux temps.
Les bonnes habitudes se prenant
dès le primaire, un oeil sur le cahier de textes ou le cahier de brouillon
permet de voir si l'enfant prend l'habitude de noter clairement les leçons
qu'il doit apprendre, donc de gagner du temps.
Au collège, les parents peuvent
aider leurs enfants à gérer leur temps, en les incitant à anticiper les
taches à accomplir et à les effectuer dans le bon ordre. Qu'est ce qui est
urgent ? Qu'est ce qui peut attendre ? Combien de temps me faut--il pour
effectuer cet exercice ? Ces questions inciteront aussi les collégiens à mieux
utiliser leurs heures de permanence et leur permettront de se ménager du temps
pour les loisirs et les moments de détente, précieux pour restructurer dans le
cerveau les informations et les mettre en mémoire. Cette répartition du travail
est d'autant plus importante qu'au lycée, les adolescents se sentiront vite
débordés s'ils n'ont pas déjà acquis le réflexe d'anticiper.
Clé du travail scolaire, la
mémoire est sélective. Elle élimine près de 75 % des informations qui lui
parviennent : celles qui sont désagréables, celles qu'on ne comprend pas...
Mais, il existe des moyens de la stimuler.
Relire ses cours le soir même
lorsqu'ils sont encore "frais" dans la mémoire permet par exemple,
selon les psychopédagogues, d'effectuer 80 % du travail de mémorisation.
Apprendre une leçon avant de faire des exercices facilite également
l'apprentissage : la leçon devient un mode d'emploi auquel l'élève revient à
chaque fois qu'il a un blocage.
La mémoire aime l'ordre.
Mieux vaut donc réorganiser ses notes afin de les rendre lisibles et de
faire ressortir l'essentiel. Les synthétiser sur une fiche, permet notamment
d'ordonner les informations en fonction de ses besoins.
Pour Antoine de La Garanderie,
c'est en imaginant la situation dans laquelle il va utiliser sa leçon que
l'élève la fixera le mieux. Les parents peuvent l'y aider en lui proposant
d'imaginer qu'il aura à décrire oralement à toute la classe la réaction
chimique qu'il est en train d'apprendre. Ou en l'incitant à se mettre à la
place de son professeur quand celui-ci l'interrogera.
Analyser une erreur ou un oubli permet
d'éviter de les refaire et, là encore, l'aide des parents peut être précieuse.
En prenant le temps de regarder avec leurs enfants leur cahier de devoir ou
leurs copies, en s'intéressant aux annotations des enseignants davantage qu'à
la note, ils pourront les amener à comprendre pourquoi ils ont échoué ou
pourquoi il n'ont pas su. Et à réfléchir aux moyens de combler leurs lacunes.
Ils peuvent aussi les aider à
repérer leurs points faibles en faisant un bilan régulier des résultats dans
chaque matière. Sans culpabiliser l'enfant : l'important est qu'il progresse.
Indispensable, l'acquisition de
méthodes de travail personnel cache toutefois un piège : celui d'un
apprentissage qui, en se focalisant exclusivement sur les méthodes au mépris
des contenus, serait une coquille vide. Car comme le souligne Philippe
Meirieu, "on ne s'approprie vraiment un savoir que s'il apporte une
solution à un problème que l'on se pose".
Le souhait de savoir lire et
écrire dans le primaire, la perspective du baccalauréat au lycée sont des
formes de motivation. Elles stimulent un désir d'apprendre que les parents
peuvent contribuer à susciter et à développer. Un enfant à qui l'on offre des
livres aura envie de se les approprier par la lecture... surtout si les
personnes autour de lui font de même. Plus tard, un film, la visite d'un musée,
celle d'un lieu historique, un séjour linguistique... seront autant d'occasions
de donner un sens à ce que le jeune apprend au collège ou au lycée.
Combien d'élèves se sont sentis davantage motivés pour apprendre l'anglais
après un séjour outre-Manche...
Une bonne orientation aussi
stimule l'apprentissage. Un jeune orienté dans une section où les matières
dominantes ne l'intéressent pas risque de se démotiver rapidement. De même, un
enfant plus à l'aise en manipulant les choses qu'en les conceptualisant aura
davantage de possibilités d'accomplissement dans l'enseignement professionnel
ou technologique que dans une section générale. D'autant qu'à partir d'un
certain âge, la perspective de préparer un avenir professionnel fait partie des
stimuli les plus efficaces de l'apprentissage.
|
CE2 et 6ème : |
Les résultats des
tests d'évaluation organisés en début de CE2 et de 6ème dans les matières
fondamentales (maths et français) comme du reste les premières notes de
l'année dans les autres classes sont des indications précieuses pour affiner
les méthodes de travail personnel de chacun. Ils permettent aux élèves de
faire le point sur leurs acquis et leurs lacunes et de redéfinir leurs
priorités : revoir tel ou tel point du programme, repenser sa façon
d'apprendre dans telle matière. Intervenant en début d'année,
ces évaluations sont une forme de diagnostic, derrière laquelle ne se profile
aucune menace de réorientation ou de redoublement, mais qui offre au
contraire à l'élève la possibilité d'évaluer les résultats de ses efforts de
l'année précédente, de se repérer par rapport au reste de la classe, mais
aussi par rapport aux exigences d'un nouvel enseignant ou d'un cycle
supérieur. Bref, de mettre toutes les chances de son côté pour réussir
l'année. |
Pour en savoir plus :
Livres
pour les adultes
- "Les devoirs à la
maison", Philippe Meirieu
(éditions Syros).
- "Réussir, ça s'apprend : un
guide pour tous les parents" (Bayard) : sur la gestion mentale.
Livres pour les enfants
- Collection "Apprendre à
Apprendre" (Magnard) six cahiers du CP à la 6ème.
- Guide des Méthodes de travail
(Dunod) : pour les lycéens.
- Collection "Méthode Plus" (Éditions du Rocher) : petits guides méthodologiques ("pour prendre des notes utiles", "pour réussir un exposé"). »
2) Extrait du site :
http://membres.lycos.fr/apprendre/
Apprendre, retenir, comment ça marche ?
Bande
dessinée à l'usage de toute personne qui souhaite savoir comment fonctionne
sa mémoire et quelles méthodes utiliser pour apprendre et retenir, à l'école ou
ailleurs...
3) Extrait du site : http://www.inrp.fr/lamap/accueil.html
L’opération : «la main à la pâte»
***
Apprendre à apprendre au collègue
Les Itinéraires de Découvertes
(IDD) :
A voir
*** Apprendre à apprendre au lycée
Les Travaux Personnalisés
Encadrés :
www.eduscol.education.fr/D0050/default.htm
***
Apprendre à apprendre en APP
1) Apprendre à
s’autoformer : Le module méthodologique de l’APP de Tarbes - Midi
Pyrénées (extrait du bulletin IOTA+)
Lundi 21 mai 13H30, je redeviens «apprenant» !
L’équipe de l’APP de Tarbes m’a invité à participer à la première demi-journée
d’un «module méthodologique». Ce module, quatre demi-journées réparties sur un
mois, est ouvert régulièrement, depuis plus de deux ans, potentiellement à tous
les bénéficiaires de l’APP et du GRETA, organisme support de l’APP. Ce module a
été conçu, testé et validé à partir du savoir-faire collectif de l’APP[1].
Annie Pinat, formatrice bureautique-secrétariat, nous accueille et nous
présente le déroulement de cette première séance regroupant une douzaine de
personnes. Les profils des participants sont variés : stagiaires bureautique ou
comptabilité DPFI, stagiaires APP pour une préparation DAEU ou pour une entrée
à l’AFPA, etc… D’entrée de jeu, le tour de table permet à chacun de se
présenter et d’exprimer ses interrogations par rapport à l’intitulé de ce
module. Vous avez dit méthodologique, bigre ! Les bénéficiaires
participent à ce module sur une recommandation lors de la séance d’accueil à
l’APP ou pour les autres formations proposées par le GRETA.
Très rapidement, Annie Pinat nous
propose une première activité pour mieux cerner la question de l’apprentissage
à partir d’une série d’outils mis au point et utilisés par l’équipe de l’APP.
Avec le questionnaire de début de séance, elle nous invite, d’abord
individuellement, à inscrire, selon notre point de vue, quelques noms, verbes
et adjectifs qui pourraient qualifier, d’une manière générale, l’apprentissage.
Une première mise en commun fait apparaître quelques repères sur la formation,
vu du coté des apprenants ; le besoin d’apprendre et la peur
d’apprendre ! Une deuxième activité, cette fois-ci plus collective, nous
amène à réagir sur six textes courts relatant des expériences d’apprentissage
extra-scolaires très variées ; la relation du grand-père avec son
petit-fils, l’apprentissage par l’expérience avec ses pairs en entreprise
pendant une période de grève, la confrontation d’un savoir théorique avec une
situation extrême dans un camp de concentration, l’apprentissage sur le tas des techniques de bibliothécaires,
etc... A partir de la lecture de ces textes, Annie nous demande alors de
produire par sous-groupe une affiche et de la présenter. Sans autre consigne,
chaque groupe s’auto-organise pour exprimer un point de vue sur ces situations
d’apprentissage. Au final, et assez rapidement et convivialement, plusieurs
constats sont partagés :
-
il existe une diversité de cheminement personnel d’apprentissage,
-
tout à chacun peut apprendre, y compris après l’école ou
l’université,
-
tout apprentissage repose sur
une motivation liée à un projet personnel qui rend chaque individu acteur
de sa formation,
-
apprendre repose sur sa
capacité à renforcer son autonomie d’apprentissage en inter-action avec
son environnement.
Voilà les mots-clés à partir desquels Annie nous expose la logique de ce
fameux module «méthodologique». Au fait, quel autre nom pourrait-on donner à ce
module : «apprendre à apprendre», «responsabilisation de sa
formation», «efficacité en formation, «APP mode d’emploi», ou «vers
l’autoformation» ? Difficile de qualifier cette approche
transversale ! En tout cas, l’objectif de ce travail vise à mieux
comprendre les mécanismes généraux d’apprentissage pour optimiser, très
concrètement, sa propre activité d’apprentissage dans une perspective d’auto
formation assistée.
Au cours de ce module, quatre
parties sont abordées :
-
Qu’est ce apprendre et
les profils d’apprentissage ? (1ère demi-journée).
-
Les techniques d’apprentissage
qui facilitent l’autonomie : mémorisation, la lecture des énoncés et des
consignes, la prise de note et la gestion du temps (2, 3 et 4éme demi-journées)
-
Temps de bilan collectif et
personnel.
Après la pause, elle-même
pédagogique !, nous nous retrouvons pour entamer notre découverte guidée
des mécanismes de l’apprentissage. Le souci de notre formatrice n’est pas
d’entrer dans les éléments théoriques trop pointus, mais plutôt de nous donner
quelques repères qui puissent faire «tilt» avec notre propre vécu, forcément
scolaire, mais pas seulement. Comment passer d’une logique de transmission du
savoir où nous étions plus ou moins passifs à une logique de co-construction des
connaissances avec un rôle plus actif dans une logique d’autoformation ?
Pour répondre à cette question, Annie Pinat dresse la série d’étapes
suivantes :
-
accepter l’idée de quitter
cette structure de pensée bien établie,
-
explorer une spirale de questionnement
et de doute où l’on se demande si l’on est capable de…,
-
vivre un temps de confusion,
plus ou moins douloureux en fonction de son passé scolaire, où tous nos repères
sur l’apprentissage vont s’effondrer…
-
avant de se restabiliser avec
une phase d’apprentissage plus ouverte et plus efficace où l’on maîtrise mieux
ses propres capacités d’apprentissage.
Spontanément, plusieurs participants s’expriment en se reconnaissant
dans ces blocages et ces doutes ! Aimer, vouloir et pouvoir
apprendre ; ces verbes résonnent bien au sein de notre groupe. Après le
partage de ces interrogations sur l’acte d’apprendre, Annie nous invite à nous
pencher sur la notion de profil d’apprentissage, deuxième point clé de
la séance, en insistant brièvement sur le fait que chacun apprend et progresse
différemment. Aussitôt dit, aussitôt fait, deux nouvelles activités nous sont
proposées pour apprécier notre profil visuel, puis auditif dans la prise
d’informations. Sans évaluer nos résultats, Annie souligne la diversité des
profils d’apprentissage et les stratégies possibles pour les enrichir…..
16h30 (déjà), mes compagnons de route et moi-même n’avons pas vu le
temps passer ! Avant de s’éclipser, Annie nous invite à mettre tranquillement,
noir sur blanc sur une feuille, les actions qui pourraient nous permettre
d’enrichir nos profils d’apprentissage dans un contexte de formation. Au
passage, elle nous indique l’adresse d’un site Internet qui donne plus
d’informations sur l’importance de la mémoire et nous confirme le rendez-vous
pour la deuxième séance. Au programme ? Ah oui ! Mémorisation et lecture des
énoncés et des consignes. C’est notre temps de consolidation. Nous travaillons,
sans la présence de notre formatrice, sur la consigne… : mettre tranquillement,
noir sur blanc sur une feuille, les actions qui pourraient nous permettre
d’enrichir nos profils d’apprentissage dans un contexte de formation… ça y est,
on y est : apprendre à apprendre !
Jean Vanderspelden - Algora, mission IOTA+ Mai 2001
Extrait de la bibliographie de l’APP de Tarbes
- Jean Berbaum «Développer la capacité d’apprendre» - Ed ESF
- Jean Berbaum «Pour mieux apprendre» - Ed ESF
- Jean Berbaum «Je sais mieux comment apprendre» - Ed de Boeck
distribué par Belin
- Jean Berbaum & Association Agone Angers «Fichier PADECA, 32
propositions pour mieux apprendre».
2) La gestion mentale à l’APP du Baugeois - Pays de Loire (ext bul. IOTA+)
Formation de
formateurs et de conseillers en pédagogie des gestes mentaux à l’APP de Baugé
De
septembre 2001 à Avril 2002, 10 salariés de Formaction 49, organisme support de
l'APP de Baugé et 2 salariés d'associations intermédiaires ont suivi les 2
premiers modules de formation à la gestion mentale.
L'équipe de
l'APP de Baugé, porteur de ce projet, a fait 2 choix importants :
- d'une part, proposer cette formation à des partenaires
locaux travaillant dans l'insertion avec des publics similaires à l'APP sur le
même territoire ;
- d'autre part, ouvrir la formation à des salariés de l’APP
occupant des postes différents des formateurs, à savoir, coordinateur,
conseiller en insertion, assistante de coordination, secrétaire.
L'équipe de
l'APP de Baugé avait 2 attentes concernant cette formation : être aidé en situation d'apprentissage notamment
avec des apprenants APP et en situation
de communication avec d'autres interlocuteurs ou au sein même de l'équipe.
Nos
objectifs prioritaires étaient les suivants :
Ä
Comprendre et analyser les difficultés d'apprentissage ;
Ä Favoriser la communication et le
respect de l’autre ;
Ä Permettre à chacun un accès plus
efficace au savoir ;
Ä Mieux connaître son fonctionnement
et celui des autres ;
Ä Devenir acteur de sa réussite.
Pour
l'équipe, l'investissement a été très important. La formation s'est déroulée sur 8 mois. Elle concernait à
la fois le personnel administratif et pédagogique et tous les Formateurs
Responsables d'Antenne. D'un commun accord, il a donc été choisi d'effectuer la
formation sur son temps personnel. Cela comprenait 10 jours de formation et du
travail à réaliser entre chaque session, travail également effectué sur un
temps personnel, en particulier la réalisation de dialogues pédagogiques.
Avec un
mois de recul, l'équipe en retire des éléments très positifs. Tout d'abord,
cette formation correspond complètement à la démarche pédagogique de l’APP.
Elle a permis à chacun de mieux connaître son fonctionnement mental en
situation d'apprentissage et de communication. Elle a bien répondu aux attentes
et aux objectifs que nous nous étions fixés. C'est pourquoi, nous avons décidé
d'aller plus loin et cela en 2 étapes.
- La première concerne la
réalisation de Profils Pédagogiques pour tous les participants. Chaque
personne est reçue pendant 1 heure et demie par Mme Sylviane GANDON pour
réaliser son profil pédagogique et, donc, approfondir le travail déjà entamé
pendant les 10 jours de formation c'est-à-dire mieux se connaître soi-même au
niveau de sa gestion mentale et de son fonctionnement dans l’ensemble de ses
activités professionnelles et personnelles.
- La deuxième étape correspond à un module de 30 heures sur
6 jours prévu au 2ème semestre 2002 pour continuer la pratique des
dialogues pédagogiques, approfondir leur analyse et rechercher les liens entre
pédagogie des gestes mentaux et démarche de formation.
En conclusion,
la pédagogie des gestes mentaux nous apparaît comme un outil indispensable pour
faire évoluer d'une part, nos modes de communication et d'autre part, nos
pratiques pédagogiques auprès des publics très diversifiés que nous rencontrons
au sein de notre APP.
Nous
souhaitons également partager notre expérience avec les APP d'Angers ayant déjà
participé à cette formation. La pédagogie des gestes mentaux mérite d' être
connue et reconnue.
Contact : Odile Debliqui – app.bauge@app.tm.fr
Pour plus d’informations : La Maison de l’initiative – Sylviane Gandon, formatrice en APP,
spécialisée en pédagogie des gestes mentaux - Tél : 02 41 81 67 70 –
E-mail : sep@uco.fr
Vous trouverez dans le Bulletin N° 46 de septembre 2001, une information plus complète sur la méthodologie des gestes mentaux. Vous pouvez le trouver sur le site www.app.tm.fr, à la rubrique : « outils et communications » où tous les bulletins parus sont disponibles et téléchargeables.
3) La pédagogie des gestes mentaux – APP Angers Segré 49 (extrait du bulletin N° 46 septembre 2001 IOTA+)
Expérimentation
sur le site de l’A.P.P PROMOJEUNES FORMATION
Depuis septembre 1999, l’APP PROMOJEUNES FORMATION met en place un atelier de méthodologie basé sur la pédagogie des gestes mentaux en référence aux travaux d’Antoine de la Garanderie (son fondateur). Cette expérimentation a donné lieu à une formation de formateurs des autres sites de l’APP. Un échange riche et une expérience qui mérite d’être partagée.
Pourquoi
cet atelier ?
Formatrice en stage à l’APP d’Angers Segré, Sylviane Lemoine, qui prépare conjointement un DEA en Sciences de l’éducation avec comme étude de recherche " la pédagogie des gestes mentaux ", a trouvé là le terrain pour expérimenter, avec succès, cette méthodologie d’aide à apprendre. Elle explique la démarche menée pendant un an dans l’APP.
"Pendant leur formation en APP, certains adultes se sentaient “seuls”, ils avaient besoin d’échanger, de communiquer et ils souhaitaient, de temps à autres, travailler en petits groupes. Certes, ces personnes ont des besoins, des niveaux et des projets professionnels ou personnels différents, mais, à la base, elles ont toutes besoin d’une méthodologie. C’est dans ce sens que les ateliers de méthodologie ont été conçus. Car, chaque personne, dans son apprentissage, a besoin de savoir comment elle pourrait s’y prendre pour effectuer tel ou tel exercice. Partant des attentes des personnes aussi bien en français qu’en mathématiques (en ce qui concerne notre APP), l’atelier a pour but de proposer des méthodes personnelles de travail, c’est à dire adaptées à ce que fait déjà la personne mentalement. En fait, dans cet atelier, le formateur s’interroge sur la m a n i è re dont chaque personne fonctionne mentalement, c’est-à-dire comment celle-ci essaie de rendre présent l’objet de perception.
Ce temps d’intériorisation mentale appelé l’évocation correspond à la manière dont la personne opère et fait exister mentalement l’objet de son apprentissage. Chaque personne développe des évocations soit auditives (elle réentend “l’objet” qu’elle a entendu), soit visuelles (elle revoit “l’objet” qu’elle a perçu) ou soit verbales (elle se parle, se commente “ l ’ o b j e t ” qu’elle a vu ou entendu). C’est ce qu’on appelle des habitudes évocatives. Chaque personne a une habitude évocative privilégiée, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas s’ouvrir à d’autres habitudes. En effet, il ne faut en aucun cas catégoriser les personnes dans telle ou telle habitude, car selon la tâche proposée, une même personne peut avoir des habitudes évocatives totalement différentes. Par exemple, une personne qui a une dominante visuelle peut avoir recours à une évocation verbale ou auditive à un certain moment donné de son apprentissage, et vice versa. Le travail du formateur, entre autres, sera donc celui d’amener la personne vers des habitudes dites complémentaires en pratiquant ce qu’on appelle un “dialogue pédagogique”. Ce dialogue est un moyen permettant de fa i re émerger les habitudes mentales préexistantes chez la personne et de les expliciter. Le formateur essaie aussi de faire prendre conscience à chaque personne du comment elle fait pour être attentive, pour comprendre, pour mémoriser, pour réfléchir ou encore pour imaginer a fin qu’elle soit encore plus performante dans son apprentissage. Ces ateliers regroupent 8 à 10 personnes une fois par semaine, et ceci pendant 1 heure 30 ". Ci-joint, vous trouverez un exemple d’atelier plus orienté vers la méthodologie que les disciplines générales. L’objectif de cette séance est de sensibiliser les adultes à la pédagogie des gestes mentaux.
Première consigne : Je vais vous montrer un dessin. Vous allez l’observer pendant une minute seulement. A la fin de cette minute, je le cacherai et je vous demanderai de le reproduire sur une feuille. Chacun fera tout seul ce travail pendant deux minutes. A la fin de ces deux minutes, vous poserez vos crayons. E n s u i t e, je vous demanderai comment vous vous y êtes pris pour fa i re ce dessin. Il n’y a pas de “bonnes” ou de “mauvaises réponses”. Seule la réponse de chacun est intéressante. Suite à cet exercice, les adultes se sont exprimés sur leur manière de faire : certains avaient revu la figure dans leur tête ; d’autres se parlaient le dessin étape par étape et d’autres encore imaginaient une maison avec des fenêtres ou une enveloppe avec un timbre et le code barre.
Deuxième consigne : Je vais vous lire un petit tex t e. Mais vous ne l’entendrez qu’une seule fois. Quand la lecture de ce texte sera finie, je vous donnerai le même texte que je va i s vous lire tout à l’heure, mais vous devrez le compléter. C’est à vous de vous souvenir des mots et de les écrire dans le trou qui correspond. Dans chaque trou, vous ne devrez écrire qu’un seul mot. Vous ne devez pas vous communiquer les réponses. Il n’y a pas de “bonnes” ou de “mauvaises” réponses. Seule votre réponse est intéressante. Vous ferez ce travail en deux minutes. “Grand-mère est venue et nous a donné à chacune une galette surprise et une tasse de chocolat chaud. Ta grand-mère est vraiment adorable, a dit Rita, en avalant une gorgée de chocolat. C’est gentil à elle de nous laisser son lit.” (les mots en gras sont ceux qui seront enlevés)
“Grand-mère est venue et nous a donné à................ une galette............. et une.......... de chocolat............... Ta grand-mère est vraiment ................., a dit Rita, en avalant une .............. de .................. C’est gentil à elle de nous laisser son ..........”. Pour retrouver les mots du texte, certains adultes ont réentendu ma voix ou se sont parlés ; d’autres ont imaginé l’histoire ou se sont vus dans la scène.
Les
cahiers des APP : Méthodologie d’apprentissage
E t, vous, êtes - vous plutôt à dominante visuelle, verbale ou auditive ? Pour le savoir, vous pouvez effectuer les exercices suivants : Ces deux exercices ont permis à chaque adulte de prendre conscience de leur manière de procéder mentalement : certains privilégiaient l’évocation visuelle alors que d’autres avaient une dominante verbale ou auditive. à venir…
4) «Stratégies d’apprentissage pour une ère nouvelle» - APP
Bayonne
Les questions : «Qu’apprenons-nous et comment
apprenons-nous ? » ne sont pas nouvelles. Depuis la nuit des temps,
Socrate et la maïeutique, nous savons que nous ne faisons qu’accoucher de bébés
(excusez messieurs !) et de connaissances que nous avions déjà en nous.
Appréhender la complexité du changement dans toute organisation humaine
(l’homme étant à lui seul, un système), demande de privilégier l’écoute, la
qualité de la communication et de poser un autre regard sur les situations.
L’idée d’apprentissage est encore trop souvent associée à la dimension
intellectuelle de la personne. De plus, compter avec ses croyances aidantes ou
limitantes, ses peurs, ses tâtonnements et ceux de l’autre fait rarement partie
des pédagogies développées. La personnalisation est novatrice en ce sens. Elle
permet d’être centrée sur la personne et ainsi, donne à l’individu les moyens
de se trouver, se retrouver ou même se rencontrer.
Dans ce fabuleux élan créatif de l’acte d’apprendre, la personne accepte
et favorise les mouvements intérieurs de son être, vagues de joies, de
surprises et de découvertes qui la portent avec émerveillement sur les rivages
sauvages de la découverte de soi. D’où, le guidage d’une pédagogie clinicienne
qui invente, nourrit et transforme, pour la personne qui la sollicite, les
concepts et outils d’un apprentissage devenu personnalisé.
En matière de développement personnel, de recherche d’épanouissement,
d’augmentation des choix, l’expérience des autres ne nous sert que .. très
rarement. « La vision d’un homme ne prête pas ses ailes à un autre homme»,
nous dit K. Gibran. Aussi la mission d’un tel pédagogue vis à vis des autres et
de lui même, va se révéler dans l’art de mettre en place les conditions
d’apprentissages les plus favorables
afin d’être l’artisan de notre vie et d’accéder à des niveaux
d’autonomie et de conscience supérieurs.
Dans cet atelier, il vous sera proposé par une approche holistique de la
communication à multi niveaux de donner un éclairage à des situations
d’apprentissage du passé, du présent et du futur et vous entrerez ainsi en
contact avec votre maître intérieur.
Contribution au cours du congrès PNL de Montréal en avril 2000 sur le
thème «Interventions personnalisées en pédagogie clinique» - Catherine
Darriet-Vandame Thérapeute, consultante en développement personnel EFP Conseil
et coordonnatrice de l’APP de Bayonne.
Apprendre à apprendre dans le secteur universitaire
1) Extrait site :
http://www.puq.uquebec.ca/sujet/apprendre_a_apprendre.html
Exemple des Presses Universitaires
du Québec
Introduction à la méthodologie de la recherche

André Ouellet :
Cet ouvrage est une introduction à la méthodologie de la recherche vue étape
par étape. L'auteur décrit de façon exhaustive et avec force détails tout le
processus et appuie son exposé par de multiples exemples. Il présente d'abord
la terminologie de base utilisée, puis décrit comment apprendre à apprendre par
la méthode de résolution de problèmes. L'approche préconisée repose
essentiellement sur l'observation-participation et sur l'expérimentation,
réduisant d'autant l'écart entre la recherche qualitative et la recherche
quantitative. 1993, 280
pages, ISBN 2-7605-0729-7, DA-729
2) extrait du site :
http://www.fep.umontreal.ca/continue/apprendre.html
Exemple du service formation de
l’Université de Montréal
*** La formation sur mesure
Apprendre
à apprendre : s’outiller pour faciliter l’apprentissage, c’est-à-dire connaître ses forces et ses
faiblesses et, partant, celles des autres, identifier ses forces et ses
faiblesses en période d’apprentissage; définir les besoins qui en découlent;
anticiper les moyens d’action pour apprendre ; prendre en mains son propre
développement et rechercher les occasions d’apprentissage et profiter de toutes
les occasions possibles pour compléter et enrichir son apprentissage;
Adresse
postale : Formation continue Faculté de l’éducation permanente Université de
Montréal C.P. 6128, succursale Centre-ville Montréal (Québec) H3C 3J7 Téléphone
: (514) 343-5873 ou 1 800 363-8876
Télécopieur : (514) 343-2430 Adresse électronique :
info@fep.umontreal.ca
3) extrait du site :
http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/Francais/metacog.htm
*** Apprendre à apprendre
Ceux qui
savent apprendre en savent assez. Le
chemin qui mène vers un apprentissage effectif passe par la connaissance de :
Soi même ou nous même - notre capacité à apprendre - la méthode utilisée avec
succès par le passé pour apprendre ; la connaissance du sujet que nous
souhaitons apprendre ou l'intérêt que nous avons pour ledit sujet. Site
s’adressant surtout à des étudiants/Accessible en plusieurs langues)
4) extrait de l’article
«Apprentissage coopératif en ligne, les apports de la recherche» d’Alain
Dericke paru dans l’AFP N° 179 de juillet août 2002
site : http://www-ganymede.univ-lille1.fr
de
«ACAO» ou Apprentissage Coopératif Assisté
par Ordinateur !
« ….
AFP :
Quels ont les objectifs de l’apprentissage coopératif ?
Alain
Derycke : Les objectifs pédagogiques directs sont souvent guidés par
quatre grands principes :
1 La collaboration : une
modalité d’apprentissage.
2 Des interactions coopératives
structurées.
3 Le groupe ne suffit pas !
4 Des stratégies pédagogies
explicites pour apprendre ensemble
4.1 Tout d’abord, l’interdépendance positive : tous les membres d’un groupe sont responsables de leur propre apprentissage et de celui des co-équipiers. De cette interdépendance découlent la nécessité d’une coordination entre les actions des uns par rapport à celles des autres et le besoin de se lier avec d’autres afin d’élaborer la totalité de la tâche.
4.2 En second lieu,
l’interaction de face à face : il s’agit de la communication formelle et
informelle, source de développement individuel, d’expression orale, de
responsabilité vis à vis du collection de rétro-action, de simulation, de
rencontre et d’interaction avec le raisonnement de l’autre. On se réfère, dans
ces cas, à la théorie des petits groupes et aux fonctions sociales de dialogue.
4.3 La responsabilité
individuelle, d’une part, et la responsabilité de groupe, d’autre part, doivent
faciliter l’émergence d’autonomie, l’un des objectifs principaux de
l’apprentissage coopératif.
4.4 Et enfin, la
formation au développement des habilities de coopération : il
s’agit de l’explicitation, la construction et l’acceptation de la connaissance,
des idées et des actions des autres. Le but est de faciliter la résolution des
conflits de manière constructive.
Pour schématiser,
on peut dire qu’il faut coopérer pour apprendre et apprendre à coopérer, ce qui
suppose aussi de développer des compétences transversales utiles pour la vie
dans le monde du travail et dans la société. Un objectif et un résultat
attendu, plus ambitieux de l’apprentissage coopératif est de rendre les
apprenants capables d’un comportement réflexif. Il se traduit par une capacité à s’interroger, au travers du processus
coopératif et de la confrontation avec d’autres pratiques et à modifier son
propre processus d’apprentissage, avec
l’aide d’un agent éducatif (tuteur). C’est-à-dire atteindre le vieux principe d’apprendre à apprendre.
***
Apprendre à apprendre en entreprise
Extrait du site http://www.fmk-consulting.com/themes-inter/f3-apprendre.html
1) «qu’est ce qu’ Apprendre à apprendre par
l’expérience ?
Apprendre à apprendre par l'expérience, c'est apprendre
au contact de son environnement dans une relation directe et authentique. A
chaque fois que l'homme interagit avec son environnement dans une recherche
d'ajustement à ses besoins, il expérimente des solutions nouvelles qui
enrichissent son vécu expérienciel et lui permettent de retrouver la
satisfaction de ses besoins. Dans ce processus d'apprentissage, l'individu est
acteur et en échange constant avec son environnement. Il est dans l'action et
dans la réflexion. Plus ce contact est intense, plus la progression est
importante. Apprendre à apprendre par l'expérience signifie que chaque individu
développe sa capacité à apprendre par lui-même de ses expériences, de manière à
ce qu'il soit capable de transformer ses situations de vie en situations
apprenantes. C'est un acte dynamique, vivant, qui lui permet d'apprendre
sans discontinuer.
2) Pourquoi Apprendre à apprendre de ses expériences ?
Plusieurs raisons peuvent motiver l'individu à développer cette capacité :
- acquérir l'autonomie de son apprentissage et devenir acteur et auteur de ses
savoirs et de ses actes,
- pouvoir s'ajuster à son
environnement au lieu de le subir et ainsi, mieux prendre en compte ses
besoins,
- découvrir un intérêt potentiel en
chaque chose qu'il réalise,
- développer sa créativité, sortir
de ses croyances limitatives et explorer de nouveaux sentiers,
affirmer son identité de personne.
Ce processus d'apprentissage associe
la pensée et l'action. De l'action va naître une théorie qui va, à son tour,
guider l'action, jusqu'au moment où l'individu trouve l'action la plus ajustée
à sa situation et à son intention. C'est ce va-et-vient entre la mise en œuvre
et la réflexion qui aide la personne à apprendre à partir de son expérience.
Pour apprendre de ses expériences, l'individu doit notamment développer ses
capacités de réflexion "dans" et "sur" l'action et
d'expérimentation de nouvelles solutions
3) Que propose Fmk consulting ?
Le développement de cet
auto-apprentissage peut se faire individuellement et collectivement. Pour que
cette démarche réussisse dans le cadre d'une entreprise, il est essentiel que
le contexte professionnel soit expérienciel et que la démarche soit relayée au
niveau du management et des ressources humaines. Pour développer cette
capacité, notre travail consiste à bâtir l'ingénierie d'apprentissage, à former
les formateurs internes chargés de la mise en place du dispositif et à en
assurer la supervision.
4) Exemple de stage proposé : FORMATION DE BASE À
L'APPRENTISSAGE PAR L'EXPÉRIENCE
Le
formateur expérienciel facilite et développe la capacité d’apprentissage par
l’expérience des apprenants. Il met en œuvre une pédagogie expériencielle
permettant aux stagiaires d’expérimenter et de découvrir différents savoirs à
acquérir ainsi que leur application. Il possède des compétences à la fois
relationnelles en termes d’accompagnement et pédagogiques en termes
d’apprentissage par l’expérience.
Cette formation a pour objectif de transmettre les bases de la pédagogie
expériencielle.
OBJECTIFS
-
Maîtriser
les concepts et les outils de base de la pédagogie expériencielle.
-
Être
capable de faire évoluer des stages existants en intégrant le processus
d'apprentissage par l'expérience.
-
Maîtriser
les compétences de base du tuteur : écoute, questionnement, observation,
communication
DURÉE ET PARTICIPANTS
2 + 2 jours. Formation destinée à
des formateurs professionnels
PROGRAMME
1ère session
• Les concepts de
l'apprentissage expérienciel.
• Expérience et
apprentissage, motivation et apprentissage.
• Le cycle de l’apprentissage (action, observation,
expérimentation, compréhension, assimilation).
• Le cycle de
l’expérience (contact, engagement, action, bilan, assimilation).
• Élaboration d’une
séquence pédagogique…
2ème session
• Feed-back sur les travaux intersessions.
• Présentation et animation de séquences expériencielles.
• Animation de mises en situation.
• Les résistances du groupe.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La pédagogie
employée sera expériencielle et comportera de nombreuses mises en situation.
Les stagiaires, de par la pédagogie, développeront leur capacité d’écoute, de
questionnement et d’observation tout au long de la formation. Les travaux
intersessions leur permettront de mettre en œuvre certaines de ces attitudes et
d’expérimenter la refonte d’une séquence pédagogique qui sera retravaillée lors
de la deuxième session. En fonction de la demande du groupe, un stage
complémentaire de perfectionnement pourrait être mis en place.
B) Les concepts et les références
B.1)
Approche : éducabilité cognitive
1) Extrait du site :
http://francois.muller.free.fr/diversifier/educabilite_cognitive.htm
François
Muller est conseiller pédagogique au rectorat de Paris et travaille avec des
enseignants de collèges. A partir des travaux d’André Peretti, il a créé
un site Internet de ressources au sens large pour les enseignants et donc pour
les élèves.
Définition :
L’éducabilité cognitive est
l’ensemble des pratiques, des techniques qui ont pour objet explicite et
principal de développer l’efficience et l’autonomisation des apprentissages et
réactivant de façon systématique les procédures de pensée, les structures
mentales dont la personne dispose et dont elle prend conscience. D’après apprendre
peut-il s’apprendre ? Les Cahiers Pédagogiques N°280
Un article
comparatiste et critique de Michel Hutteau et Even Loarer, (Éduquer et
Former - Éditions Sciences Humaines 1998) - à lire avant d'aller plus loin.
http://perso.guetali.fr/castjpau/Resscom/educabilité_cognitive.htm
un site entier consacré à
l'éducabilité cognitive
- l'université Paris XII - Val de Marne, dont quelques
chantiers en cours et interactifs :
Les
environnements favorables à la modifiabilité cognitive
Adaptation des méthodes
utilisées avec des sourds pour des personnes en difficulté d'insertion
Passerelles
entre les méthodes d'éducabilité cognitive et les enseignements disciplinaires
L'espace
et le temps comme axe de repère et de jonction entre les générations
Insertion
et apprentissage dans le cadre de l'illettrisme
Insertion et apprentissage
dans le cadre de l'emploi
Les repères de l’éducabilité
cognitive
Apprendre
Apprentissage
Carl Rogers
Piaget
Psycho-cognitive
Transférer
Les outils
et démarches de l’éducabilité cognitive :
Le Programme d’Enrichissement Instrumental
Historique : Années 50 en Israël; éducation de jeunes orphelins par Feurstein.
Un test LPAD (instrument d’évaluation du potentiel d’apprentissage) nécessitant
l’intervention active (médiations) lui permet de constater des progrès
sensibles en quelques heures.
Postulat : L’existence en tout individu d’une
possibilité de MODIFICABILITE STRUCTURELLE COGNITIVE qui émergera à condition
de développer une attention active modifiante, en instaurant des médiations
entre le sujet et le réel. Physique ou social.
Objectifs : Durant ces années, Reuven Feuerstein développe et
applique dans les kibboutz israéliens son Programme d'Enrichissement
Instrumental (P.E.I.). Selon lui, toute personne, peu importe sa
condition, peut améliorer son efficience intellectuelle. À l'aide d'exercices
inspirés en grande partie des épreuves des tests d'intelligence non verbaux, il
procède à la modifiabilité cognitive par un processus de
"remédiation". Son but est d'améliorer les compétences
instrumentales de l'élève en vue d'accroître ses capacités d'apprentissage.
Le PEI vise une modification durable des structures
intellectuelles permettant l’automatisation et l’autonomisation par rapport à
l’apprentissage. - Corriger les fonctions cognitives - Enseigner le vocabulaire, les concepts, les opérations -
Développer la motivation personnelle et le recours à un traitement intellectuel
des problèmes - Développer la capacité à prendre conscience et à comprendre ses
propres processus de pensée (dans la réussite ou l’échec) - Assurer le
transfert systématique des stratégies acquises dans la vie.
Moyens : 14 instruments présentés sous forme d’exercices
papier-crayon de difficulté progressive et qui ne nécessitent aucune
connaissance scolaire ou technique.
Son programme comprend plus de 500 exercices regroupés à l'intérieur de
14 instruments de travail: 1) organisation de points, 2) orientation spatiale
I, 3) orientation spatiale II, 4) comparaison, 5) perception analytique, 6)
classification, 7) relations familiales, 8) relations temporelles, 9)
progression numérique, 10) consignes, 11) syllogismes, 12) relations
transitives, 13) représentation, stencils et design, 14) illustrations ou histoires
sans parole.
Quelques limites : Le principal inconvénient de cette
approche est qu'elle exige une formation longue et coûteuse. Problèmes de
traduction. Problème culturel : classer des navires de guerre… Problème de
rigueur : beaucoup de notions semi-mathématiques ; on ne parle pas
d’angles mais de coins. Problème de transfert. Feuerstein n’a jamais
cité ses sources car il se considérait comme un visionnaire : le PEI est
donc considéré comme n’étant basé sur aucune théorie or il y a utilisation des
travaux de Piaget, Rey et Vygotski. L’évaluation n’a jamais été prévue.
Le PEI est de l’ordre des compétences, de la méthodologie mais pas des
contenus. En France, il est insufflé dans les cours.
Le jeu complet des 14 instruments du PEI peut être
commandé à : DFD Brive - 16 Avenue Pasteur - 19100 - BRIVE – 300, 00 Frs
HT
NB : Marque déposée !!!!
Pour aller plus loin:
Bibliographie thématique et complète sur le
site de Daniel Calin (consacré au CAPSAIS)
Bibliographie actualisée
sur un cours de l'université de Paris V "remédiation cognitive et
méta-cognition", cours de J Lautrey
La Programmation Neuro-Linguistique
ou PNL
Une fiche avec des
outils, établie par G. MISSOUM - in EPS Juillet-Août 91 (sur le
site de J.P. Castex)
LES OBJECTIFS : permettre à l'élève, au sportif, à l'enseignant, au coach de :
Prendre conscience de son corps et
d'affiner ses sensations ; contrôler l'anxiété ; maîtriser l'émotivité ;
améliorer le contrôle du stress ; contrôler la souffrance ; gérer la
douleur et la fatigue ; améliorer la capacité d'attention et de
concentration ; renforcer la motivation ; accroître la combativité ;
améliorer la confiance en soi ; contrôler les pensées négatives ; gérer
les objectifs ; implanter de nouveaux comportements ; optimiser et accélérer
l'apprentissage ; améliorer la communication..
La
Gestion Mentale
COMPRENDRE LA GESTION MENTALE
Michèle VERNEYRE
- Les cahiers
pédagogiques
Les travaux d’Antoine DE LA GARANDERIE sur la gestion mentale
reposent sur la NOTION D’ÉVOCATION.
Il ne suffit pas de percevoir pour comprendre et mémoriser.
Il faut aussi se redonner mentalement le message reçu.
* Trois types d’OBSTACLES à l’intégration de
ces travaux:
1 - Communs à toute nouveauté:
- réactions affectives de défense
(interprétation en fonction de ce que nous savons déjà). Les plus grandes
âmes sont capables des plus grands vices et des plus grandes vertus. DESCARTES
- La rigidité de nos schémas de
pensée
- Le manque de consensus : AVANZINI :
" L’immobilisme n’est pas menacé.... immobilisme et novation
varient dans le même sens. "
2 - Les obstacles spécifiques
- L’introspection : elle
rappelle l’examen de conscience ou l’auto-critique; l’auto-analyse s’intéresse
au COMMENT et non au POURQUOI : Comment pensez-vous à telle chose ? Et non -
Qu’est-ce que vous en pensez ?
- L’entrée dans la BULLE
PROXÉMIQUE : crainte de s’approcher trop près (peur d’être indiscret).
Nécessité d’une tierce personne Michel SERRES, du médiateur de FEURSTEIN, de la ZPD
de Lev Vygotsky.
- L’inconscient poubelle : 2 conceptions de
l’inconscient s’opposent
. une héritée du freudisme
(inconscient = cloaque, poubelle du refoulé)
. l’autre qui veut montrer que le
cerveau et l’affectif ont stocké une foule de stratégies et d’apprentissages
oubliés qu’il est possible de rendre conscients. Stratégies et apprentissages
transposables à des situations nouvelles (pour lesquelles ils seraient des
remédiations).
3 - Les difficultés techniques à situer l’évocation : une
approche trop rapide des travaux de DE LA GARANDERIE empêche de déterminer le profil
d’apprentissage.
. Le choix du vocabulaire qui doit
être simple pour être accessible sans dictionnaire. En gestion mentale, on
s’attache à la direction donnée à l’activité mentale, aux différents supports
et aux démarches utilisées avant de s’intéresser aux contenus.
Antoine DE LA GARANDERIE se sert
des qualités auditives et visuelles pour QUALIFIER LE CODAGE INTÉRIEUR, les
façons de se redonner mentalement le perçu.
. La confusion entre PERCEPTION ET
ÉVOCATION : " je ne peux rien retenir si je ne l’ai écrit ou vu
écrit, c’est donc visuel ". Non cela indique tout au plus un
besoin d’appropriation.
. La confusion entre ÉVOCATION et
RESTITUTION : " Puisque je fais toujours des plans, des schémas,
j’ai donc un fonctionnement visuel ". NON, on peut tout aussi
bien dessiner les idées que l’on s’est données mentalement, les mettre en plan
organisé, que recopier le plan tout imprimé mentalement.
. La confusion entre COMPÉTENCE et
MODE DE FONCTIONNEMENT : Extrapolation courante : " Si je suis
physionomiste, si j’ai une bonne mémoire des lieux, c’est que j’ai des images
dans la tête et que je suis de la famille - visuel ".
. La confusion entre sujet à
traiter et mode de fonctionnement : s’il est vrai que la perception est plus
facile à coder mentalement quand le support perceptif correspond au canal de
codage (ex : pour un sujet qui évoque visuellement, une image est plus
facilement codée), ce n’est pas pour autant que les professeurs de
mathématiques ou d’arts plastiques évoquent visuellement et qu’en histoire il
faut un fonctionnement auditif.
. La méprise entre le début et la
fin du cheminement mental.
L’analyse transactionnelle
POUR UNE COMMUNAUTÉ DÉCONTAMINÉE Yves DUCRET - Revue JDI novembre 1994
L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE AU SERVICE DE L'INSTITUTION SCOLAIRE... Yves DUCRET
NOUS LAISSE ENTREVOIR LE CARACTÈRE OPÉRATIONNEL D'UNE APPROCHE QUI NE MÉPRISE
PAS LES PRÉOCCUPATIONS PRAGMATIQUES. ELLE PEUT RENDRE BIEN DES
" SERVICES " EN DIRECTION DES PARENTS, MAIS AUSSI DANS LES
CHEMINS QUI MÈNENT À SOI.
II
serait tentant (et rassurant, d'une certaine manière) de définir l'école comme
le lieu où les enfants apprennent à être et à connaître, et où les adultes
seraient au service de cet apprentissage. Mais une école, comme tout lieu de
vie, c'est aussi l'endroit où les conflits, le stress, les désaccords,
l'implication des uns et le désintérêt des autres se rencontrent et se
heurtent. Or, pour être à l'écoute des enfants, n'est-il pas indispensable
aussi que les adultes sachent se comprendre, s'entendre et se respecter ?
L'analyse transactionnelle est justement un outil de communication qui permet
la véritable écoute et la véritable compréhension des autres. L'expression même
" analyse transactionnelle " est presque rébarbative. Si le
mot " analyse " ne pose guère de difficulté sémantique, il
est peut-être utile de décomposer l'adjectif " transactionnelle"
[trans/actio]:
- trans, du latin trans, au-delà, à travers,
préfixe qui implique l'idée de changement, de traversée, de passage;
- action, du latin actio, faculté d'agir,
manifestation de la volonté.
L'analyse
transactionnelle, ce serait donc une réflexion sur le changement possible de
nos actions : comment faire pour agir de la façon la meilleure possible pour
nous-même et pour les autres ? Or l'analyse transactionnelle n'est pas qu'une
réflexion sur nos actions ; car la
transaction, en terme d’ A T., c'est la communication interpersonnelle (plus
simplement, les échanges qui régissent notre vie quotidienne avec les autres,
face aux autres). Cependant, avant même de songer à communiquer efficacement
avec ses pairs - sans commettre d'impairs... - ne faudrait-il pas savoir
discerner clairement à quels niveaux se place l'échange, et quels mécanismes se
mettent en branle, mécanismes qui s'enclenchent souvent à notre insu ?
L'analyse transactionnelle peut nous aider à décrypter de façon précise et cela
n'est pas le moindre de ses avantages... ces mécanismes.
" LE TRIPLE MOI "
Freud avait
mis en exergue le moi, le surmoi et le ça. Éric Berne, le fondateur de
l'analyse transactionnelle, définit plus simplement (parce qu'au niveau plus
facilement accessible du conscient) la personnalité de chacun selon trois états
: le Parent ; l'Adulte ; l’Enfant. La différence fondamentale, entre ces deux
théories, porte sur l'accessibilité à ces états. Le moi, le surmoi et le ça,
relèvent de l'inconscient. Seul un long (et coûteux) travail d'analyse permet
de mettre au jour les arcanes de cet inconscient. Les trois états du moi
définis par Berne, au contraire, sont des états directement observables,
modifiables. Plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement, bien sûr, mais
les modifications souhaitées, au niveau
comportemental, sont d'une mise en application concrète (lire ci-contre).
L'ADULTE AU CŒUR DU SYSTÈME.., DE COMMUNICATION
Dans
le travail quotidien d'un directeur d'école, l'analyse transactionnelle permet
de réguler le groupe en décelant les " jeux psychologiques "
mis en place par chacun, et en les remplaçant par une négociation d'égal égal.
Un "jeu psychologique", en A T., est un mini-scénario de vie.
Le scénario, c'est la trame suivant laquelle nous tissons notre vie jour après
jour, trame mise en place à partir des messages verbaux et non verbaux reçus
depuis notre naissance. L'injonction première d'un scénario de vie peut être
extrêmement contraignante, dévalorisante, mais nous nous sentons obligés de
nous y conformer car c'est notre seule référence, cette référence qui nous a
permis sinon d'être aimé, du moins d'être accepté par notre entourage. Nous
nous sommes construits à partir de cette injonction, nous avons construit notre
scénario autour, et changer peut paraître menaçant. Un scénario peut être
destructeur, mais il présente l'avantage, pour celui qui le suit depuis des
années, de le préserver de ce qui lui est inconnu. Et l'inconnu, voilà ce qui est
dangereux, bien plus, se dit-on plus ou moins consciemment, que les bénéfices
que je pourrais (peut-être) tirer de ce changement !
LE JEU PSYCHOLOGIQUE
Le
jeu psychologique est un mini-scénario en ce sens qu'il est bref, rapide,
intense ; il sert à valider le scénario de base, à conforter l'idée que nous
nous faisons de nous. Imaginons un instant le dialogue suivant : Le
Directeur: Je viens de recevoir les nouvelles directives concernant
l'application de la réforme. Échange d'une information : communication sur
le mode de l'Adulte à l'Adulte de l'interlocuteur.
L'instituteur:
Ah oui, la réforme ! Pas évident, hein ? Position d'attente :
communication sur le mode Adulte/Adulte.
Le
Directeur : Il va falloir s'impliquer de façon beaucoup plus active.
Subtil sous-entendu : "Ce qui n'est pas le cas." Apparition du Parent
persécuteur.
L'instituteur:
De toute façon, pour ce que ça changera ! Beaucoup de bruit pour rien, si tu
veux mon avis. Communication sur le mode Parent persécuteur. Le dialogue
qui s'instaure est déjà fortement compromis. D'un côté, un instituteur qui
s’instaure dans un scénario de victime (On ne peut rien faire). De l'autre, un
directeur qui suit son scénario de Parent persécuteur (Tu es un incapable).
N'aurait-il pas été plus constructif de fonctionner sur un autre mode de
communication ? Peut-être ainsi : Le Directeur: Je viens de recevoir les
nouvelles directives concernant l'application de la réforme.
L'Instituteur:
Ah oui, la réforme ! Pas évident, hein ? Le Directeur: Intéressant en
tout cas. Nous allons nous réunir pour voir ensemble ce que nous pourrons
mettre en place. Communication sur le mode Adulte. L'Instituteur : Oui,
tous ensemble on y verra sans doute plus clair. Réponse elle aussi sur le mode Adulte.
Le
jeu psychologique est toujours nocif : les strokes échangés ne servent qu'à
recevoir des signes de reconnaissance négatifs. Rompre un jeu psychologique et
le remplacer par un mode de communication honnête qui prenne en compte
l'interlocuteur (" j’accepte ce que tu es "), voilà ce que
permet, entre autres choses, l'analyse transactionnelle.
VALORISER L'AUTRE
En
tant que directeur d'école, les champs d'application sont très divers. Ainsi,
lorsque l'intervention des services techniques s'avère nécessaire, plutôt que
d'établir une simple liste des travaux à effectuer, il est beaucoup plus
valorisant pour les ouvriers de leur adresser une lettre rédigée : ce qui
servira de strokes ici, ce seront les formules épistolaires en elles-mêmes
(personnalisation de la demande, formules de politesse, remerciements, etc.).
Lorsqu'un rappel à l'ordre est nécessaire mieux vaut d'abord porter l'accent
sur les points positifs pour revenir ensuite à ce que l'on souhaite obtenir.
Imaginons qu'aux cuisines, le personnel ne porte pas les bonnets préconisés par
le service de l'hygiène. Une sèche réprimande (ou même une simple remarque) a
peu de chance d'être bien reçue : émise sur le mode Parent persécuteur (ou au
mieux normatif), le risque est grand que l'interlocuteur réagisse comme
l'Enfant (rebelle ou soumis). Mais si l'on valorise l'autre par des strokes
positifs, en mettant en avant ses compétences (qualité des repas, présentation
des plateaux, propreté...), il sera beaucoup plus facile ensuite de dire :
" Simplement, vous savez que le port d'un bonnet sur les cheveux
est obligatoire. Je sais que ce n'est pas très pratique, mais l'hygiène
l'impose. Merci de respecter cette règle. "
L'A.T., UN OUTIL DE RÉGULATION
Il
ne s'agit pas de manipuler les autres ; I'analyse transactionnelle ne sert pas
à assouvir le besoin de pouvoir, ni à imposer. L'analyse transactionnelle offre
la possibilité de résoudre les conflits, de déjouer les pièges d'une
communication truquée par les jeux psychologiques, et d'œuvrer ainsi,
quotidiennement, au mieux-être de la communauté scolaire.
2) Extrait du site :
http://www.psychotech.qc.ca/Chatel.htm
Exemple Québécois
Logiciels de remédiation
cognitive
Les
logiciels de re-médiation cognitive sont utilisés auprès d’enfants et d’adultes
présentant des troubles d’ordre cognitif, touchant principalement les fonctions
d’attention et de mémoire, de perception et de langage. Ils permettent également
un travail au niveau de la résolution de problèmes. Les 25 logiciels de la
série «RÉÉDUC» sont de type exerciseur. Ils sont utilisés à des fins
d'entraînement cognitif auprès de personnes éprouvant divers problèmes d'ordre
cognitif. Clientèle visée : Enfants et
adultes qui éprouvent des désordres de l'attention associés ou non à de
l'hyperactivité, des problèmes de distraction ou de concentration. Le logiciel
peut être utilisé à titre d'activité éducative complémentaire pour les
personnes sans problème particulier.
Le Réseau Psychotech inc., 2406, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 300, Sainte-Foy (Québec), Canada, G1V 1W5 Tél : (418) 659-7000 Fax : (418) 659-7010
- Livre «Pratiques nouvelles en éducation & formation»
L’éducabilité cognitive» - collectif dirigé par M Sorel - L’Harmattan – 1994
-
Bibliographie en ligne
Les pédagogies de l’intelligence -
Daniel Calin
http://daniel.calin.free.fr/biblio/penser.html
-
Références
philosophiques
-
Références
psychologiques
-
Références
psychiatriques
-
Théorie
de l’apprentissage
-
Approches
socio-cognitives
-
Approches
pédagogies générales
-
Approches
didactiques
-
Les
pédagogies de l’intelligence
-
Pédagogies
et déficiences
-
Colloques
-
Autres
références
Fiches
sur la Remédiation» de l’ERAP région Bourgogne
http://perso.wanadoo.fr/erap/fiches/list_rem.htm (lien obsolète)
B.2) Approche :
accompagnement
LA PRATIQUE HISTOIRE
DE VIE
Souvent,
lorsque les apprenants ont des difficultés pour apprendre à apprendre, c’est
qu’il leur est demandé de «toucher» à leur identité. Paul Ricoeur dit
que «l’identité n’est que récit» Soi-même comme un autre. En effet,
l’identité de chacun peut se révéler en apprenant à se raconter, et souvent en
confrontant son récit avec celui des autres. Pour aider les apprenants à
apprendre à se projeter dans l’exercice de nouvelles activités, il est d’abord
nécessaire de leur permettre d’identifier un capital de compétences qu’ils
possèdent déjà en se racontant afin qu’ils se les reconnaissent et puissent se
les approprier.
Dans «Histoires de vie»,
Gaston Pineau affirme que «Faire son histoire de vie, c’est s’émanciper
des différents déterminismes, c’est contrer les contres (…) c’est
s’appuyer sur le passé pour en décoller et entrer dans les mouvements pleins de
contradictions du devenir de façon motrice (…) faire son histoire de vie est
alors moins se souvenir qu’advenir».
La prise de pouvoir par
l’apprenant de son devenir est au cœur de la problématique apprendre à
apprendre. L’approche histoire de vie est une approche qui peut permettre de se
réapproprier l’écriture, lever des inhibitions cognitives, restaurer
l’autonomie de l’apprenant, développer son sentiment d’appartenance à un groupe
culturel etc. Elle peut aussi permettre à chacun de décrire la façon dont il a
dépassé des difficultés passées mais aussi décrire des expériences qu’il a
réussies et ainsi se découvrir un capital de compétences pour dépasser les difficultés
futures.
Les exercices proposés qui
permettent aux apprenants de mettre en mots ce que chacun sait faire, ce à quoi
chacun croit, de décrire ses goûts, ses choix et ses rêves passés, leur
redonnent confiance en eux. Le fait d’être écouté leur redonne confiance dans
les autres. La découverte de ressources cachées renvoie à l’apprenant une image
plus positive de lui-même. Les capacités qui émergent sont souvent des
capacités enfouies qu’ils ne se reconnaissaient pas. De la considération
renvoyée par le formateur ou par les autres participants, le récit revêt une
dimension éthique.
La pratique «histoire de
vie» aide également à résoudre le problème : Pourquoi une personne placée dans
l’obligation de se reconvertir par son institution, se sent-elle trahie,
abusée ? Pourquoi le sujet qui n’arrive pas à s’insérer, ressent un
sentiment d’exclusion sociale qui dépasse le sentiment d’exclusion
professionnelle ?. La pratique «histoire de vie» qui est une pratique pour
réfléchir sur soi joue un rôle prépondérant sur la motivation de l’apprenant à
développer sa confiance dans les autres. C’est aussi par cette voix que
l’apprenant prendra la décision d’investir suffisamment de sa personne pour
apprendre à apprendre et faire le choix de s’insérer professionnellement.
Références : «Le bilan
personnel et professionnel» - Arlette Yatchinovsky et Pierre Michard ESF
éditeur & «Histoire de vie» - Pierre Michard et Arlette Yatchinovsky
ESF éditeur
LA PRATIQUE DE
L’AUTOFORMATION ACCOMPAGNEE
- Extrait du chapitre «L’autoformation accompagnée en APP ou les sept piliers revisités... » du livre « Les APP ou l’autoformation
accompagnée en acte » - Les
éditions l’Harmattan - 2002
Troisième
pilier : la préformation, propédeutique de l’autoformation ?
Nous entrons ici dans une zone floue
de la pratique en APP et en centre d’autoformation. Si tous les interlocuteurs
y acceptent sans état d’âme la nécessité d’un travail méthodologique spécifique
sur les techniques pour apprendre, plus particulièrement lors de la transition initiale
du système éducatif conventionnel vers ces nouveaux dispositifs plus
autodirigés, encore trop rares sont les expériences de terrain qui ont mis en
pratique cette déclaration d’intention consensuelle. Et ce, encore plus quand
il s’agit de mettre en place un «sas» de préformation à ces nouvelles
approches.
Même s’il est amplement justifié par
les travaux d’experts ou de chercheurs sur les conditions pour «apprendre à
apprendre», ce besoin de préformation
est peu formulé sur le terrain. Il a été noté comme le point aveugle de la
comparaison entre le modèle des sept piliers et le cahier des charges des APP
par nos observateurs-praticiens. Notre expérience personnelle du montage de
mécanismes de préformation en centre de ressources dans de grandes entreprises
mène à un constat similaire. Tant pour des raisons de budget-temps que de flou
des représentations, cette phase préliminaire de travail est vécue comme
souhaitable mais non indispensable, toujours trop lourde à organiser et longue
à animer, finalement peu opérationnelle et donc rapidement considérée comme
superflue.
Sans doute, est-ce, qu’à travers ce
positionnement de la préformation comme « pilier » en soi, on aura
indûment privilégié ce moment initial d’une nécessité pédagogique qui
l’englobe : la formation des néo-apprenants aux méthodologies de l’apprentissage autodirigé. Ce thème de
travail, justifiable d’un traitement plus large que le recours à la seule
« préformation » du nouvel arrivant, implique néanmoins sans doute un
regard spécifique sur cette phase de travail particulière de l’arrivée en APP,
en centre de ressources ou d’autoformation. En effet, c’est sans doute dans les
premiers jours que se cristallisent un certain nombre de représentations (de
soi comme auto-apprenant, des ressources disponibles, des méthodes de travail,
des relations avec les formateurs) susceptibles de surdéterminer le déroulement
des épisodes ultérieurs d’apprentissage. Toutefois, la formation méthodologique
d’ensemble de l’apprenant (et donc du formateur si nécessaire) dépasse cette
seule problématique du moment initial.
Bien que la notion de préformation
méthodologique soit absente du cahier des charges, celle d’accompagnement méthodologique y est
bien présente. L’une des deux dimensions de la « pédagogie personnalisée »
est :
« Un appui
méthodologique, qui pourra être individuel ou collectif, sur la manière
d’organiser un travail personnel, de structurer ses connaissances, d’évaluer
ses acquis et ses compétences, et de savoir tirer parti des ressources
existantes en matière de conseil, de documentation, de formation en centres ou
à distance ».
Certaines expériences d’APP, de plus en plus repérables semblent bien
indiquer qu’il existe dans le réseau de nombreuses démarches et projets de
travail pédagogique autour de la thématique de la « méthodologie
d’autoformation », des « méthodes d’apprentissage » ou encore du
« méta-apprentissage ». Sous ces termes, on regroupera différentes
appellations plus ou moins techniques de pratiques qui vont des méthodes
d’éducabilité cognitive à l’autorégulation, en passant par les stratégies
d’auto-apprentissage, l’entraînement métacognitif et les ateliers pour «apprendre
à apprendre». Par exemple, l’APP de Tarbes développe un «atelier
préparatoire à l’autoformation» autour de ces approches ; celui d’Angers
Segré expérimente une «pédagogie des gestes mentaux»[2] ;
un APP de Bourgogne a construit une action innovante intitulée «stratégies
d’apprentissage et autoformation» qui a fait l’objet d’un document largement
référencé d’une soixantaine de pages...
C’est bien d’ «apprendre à
apprendre» qu’il s’agit, dans la phase d’entrée à l’APP comme ensuite... Si
les premières versions des « sept piliers » avaient, sans doute à
juste titre, souligné l’importance de cette formation méthodologique initiale
(à l’orientation, à l’autodocumentation, à l’autogestion des ressources et à
l’autorégulation des apprentissages), il nous revient aujourd’hui de proposer
un amendement à cette présentation peut-être exagérée de l’effort initial, et
d’en relativiser l’importance. Et si le passage par l’APP, ou le centre
d’autoformation, devait remplir, dans toute sa durée, cette fonction
de préparation permanente à l’ « apprenance [3] »,
comme « habitus »
nécessaire au développement des sujets sociaux dans une société cognitive en
construction ? [4]
Dès lors, l’apprenant deviendrait
« propédeute » de sa formation permanente autodirigée. L’APP ou le
centre de ressources, serait le lieu de découverte d’autres manières
d’apprendre, d’autres moyens d’accéder à des ressources, ou, pour user de mots
savants, d’un nouveau paradigme éducatif, qui transformerait sa vision du sens
de la transaction éducative pour la suite de sa vie adulte. Vision généreuse,
vison idéaliste sans doute, mais vision appuyée sur l’observation de pratiques
actuelles, plus ou moins formalisées, plus ou moins sophistiquées, plus ou
moins efficientes sans doute, mais qui pointent toutes vers la nécessité d’un
investissement spécifique recentré sur les méthodologies de
l’auto-apprentissage.
Dans cette optique, notre troisième
pilier, élargi de la phase d’accueil à l’ensemble du processus, étend sa
vocation propédeutique à l’ensemble du processus et propose de donner à la
formation méthodologique des participants un statut plus ambitieux, qui devra
sans doute encore longtemps se développer sur un mode de recherche-action.
Philippe Carré
- La galaxie de
l’autoformation - Université de Nantes
http://www.fc.univ-nantes.fr/PAGES/autoformation/menuAutoformation.html
Le soleil «apprendre par
soi-même», avec ses planètes :
- approche éducative ; apprendre dans des dispositifs
ouverts
- approche cognitive ; apprendre à apprendre
- approche intégrale ; apprendre hors des systèmes éducatifs
- approche existentielle ; apprendre à être
- approche sociale ; dans et par le groupe social
C) Le changement en formation
Si
nous avons introduit ce passage dans un recensement des méthodes pour apprendre
à apprendre c’est qu’il nous semble qu’apprendre à apprendre, c’est aussi
apprendre à changer. Prendre conscience de son propre comportement en situation
d’apprentissage
Tout
individu est enfermé dans des règles de jeu, qu’il met en œuvre malgré lui face
à toute situation. Si les jeux auxquels jouent des individus entre-eux, sont
mis en lumière, il leur devient difficile de continuer à y jouer en toute
innocence. C’est en leur prescrivant un comportement paradoxal que Paul
Watzlawick leur permet de ne « plus faire plus de la même chose »
et ainsi de changer.
Contrairement à ces injonctions paradoxales, il
n’est pas question, en formation, de faire changer les individus sans qu’ils
comprennent pourquoi ça marche. Il s’agit davantage de les aider à redevenir
maîtres d’une situation qui leur échappe. Les méthodes pour apprendre à
apprendre ont été transférées du champ de la thérapie vers celui de la
formation pour aider les individus à entamer positivement des reconversions qui
étaient souvent radicales. Lorsque des pans entiers de l’industrie ont été
supprimés, considérablement réduits, ou transformés (industrie minière, textile
ou automobile…) leurs salariés se trouvaient confrontés à des apprentissages
nouveaux pour lesquels ils n’avaient pas été préparés.
La
modifiabilité cognitive, c’est à dire la capacité de chacun d’améliorer son
accès à la connaissance a été mise en lumière par le professeur Feuerstein,
grâce au Programme d’Enrichissement Instrumental. Ce
programme qui a permis de reconstruire
les capacités cognitives d’enfants qui, pour des raisons historiques, étaient
privés de médiation maternelle indispensable à l’apprentissage, a été repris
dans le champ de la formation d’adultes. Ainsi des méthodes cognitives ont vu
le jour. Le P.E.I. a été adapté
au public adulte en reconversion, puis sont apparues des méthodes telles que
les Ateliers de Raisonnement Logique, TANAGRA, Activolog, les
cubes de Mialet, etc...
L’idée
maîtresse de l’ensemble de ces méthodes est que l’on peut apprendre à
apprendre, et placer les apprenants en position méta en leur donnant accès aux
règles des règles. La position méta permet aux apprenants de prendre
suffisamment de recul pour comprendre ce dont ils ont besoin pour apprendre et
pour s’en servir. Le cognitif assure une fonction adaptative, il se place dans
une réalité matérielle et sociale qui englobe le sujet dans son environnement. Jean
Piaget qui s’est penché sur le développement de l’intelligence, écrivait en
1965 « Penser logiquement, c’est penser socialement ». L’affectif et
l’intelligence sont étroitement liés, leur relation est essentielle face à tout
apprentissage nouveau. L’homme est un tout, pour changer, on ne peut distinguer
personnalité et apprentissage. Changer, c’est pouvoir considérer son propre
comportement et décider de le faire évoluer.
Avoir
accès à sa propre intelligence
Là
où les exercices scolaires permettent le plus souvent de vérifier que
l’apprentissage a eu lieu, dans les méthodes cognitives, ils mettent
l’apprenant en situation d’apprendre. Pour les individus qui ont depuis
longtemps effectué des tâches routinières, ou pour ceux qui ont été confrontés
à des échecs en matière d’apprentissage, les méthodes cognitives présentent un
intérêt à plusieurs titres.
Elles
permettent d’aborder les changements avec un autre regard.
Elles
préparent à tout apprentissage nouveau de quelque nature qu’il soit.
Elles
autorisent chaque futur apprenant :
-
à se dérouiller les
méninges, c’est à dire à mettre à jour des capacités de raisonnement et de
résolution de problèmes,
-
-
à recenser ses
potentiels et son ouverture vers des choses nouvelles,
-
-
à faire resurgir des
acquisitions enfouies, pour regagner confiance en soi.
-
-
à oser changer.
Elles
permettent :
-
-
d’apprendre à affronter
des situations nouvelles,
-
-
de capitaliser des
méthodologies personnelles de résolution de problème face à des situations
difficiles,
-
-
d’acquérir de nouvelles
méthodes pour se lancer dans des apprentissages nouveaux sans avoir peur.
-
-
de porter un regard
différent sur un nouvel apprentissage dû au contexte
-
-
l’acquisition de
méthodologies qui ne rappellent pas l’école
-
-
et enfin, d’agir de
façon progressive sans évaluation contraignante grâce à un rééquilibrage des
acquis antérieurs sans frustration et sans sanction.
Les méthodes pour apprendre à apprendre favorisent l’autonomie de l’apprenant, elles présentent un intérêt tout particulier pour les publics de bas niveau de qualification et pour ceux qui ont effectué pendant longtemps des tâches répétitives. Ces publics doutent souvent de leurs capacités face aux changements. Ils pensent qu’ils seront incapables de résoudre des problèmes auxquels ils ne sont pas préparés. Les méthodes cognitives les initient à des méthodes simples pour décoder une réalité qui leur résiste.
Les règles que chaque individu
s’impose
Comment
devenir conscient de ses propres règles
P. Watzlawick, J.
Weakland et R. Fish dans - «Changements,
paradoxes et psychothérapies» édition Points - insistent sur la difficulté
pour ceux qui instaurent des règles au sein du système auquel ils
appartiennent, de produire eux-mêmes les nouvelles règles qui leur
permettraient de changer les anciennes et ainsi d’introduire des changements.
On remarque dans les
entreprises, qu’une réflexion sur le mythe fondateur permet souvent de mettre
en lumière les règles dans lesquelles ces dernières se trouvent enfermées et
qui les freinent face à l’introduction de changements. Ainsi, à titre
d’exemple, dans une entreprise industrielle en difficulté, l’exercice fait
apparaître que concernant la gestion des ressources humaines, l’ensemble des
règles a été repris en étant inversé. Quant au processus de fabrication, qui
pourrait lui aussi être un frein au développement, sa remise en cause n’a même
pas été envisagée ! C’est ainsi que le mythe continue, en étant repris,
soit à l’envers, soit à l’endroit.
L’exercice des neufs points,
également cité par J.L Le Moigne dans «La théorie du système
général», illustre cette incapacité, caractéristique de la réelle
difficulté pour tous de sortir des règles que l’on s’impose à soi-même.
La question posée est de
rejoindre les neufs points sans relever son stylo en ne traçant que quatre
lignes :
. . .
. . .
. . .
Tant
que la personne qui essaie de résoudre cette énigme reste persuadée que la
solution consiste à rejoindre les points sans sortir du cadre il lui sera
impossible d’y parvenir. Cet exercice, souvent utilisé en approche systémique
pour illustrer ce que veut dire sortir de son cadre pour penser autrement, est
ici un moyen pour les auteurs de montrer ce qu’est un changement opérant sur la
règle à l’intérieur de laquelle le joueur joue.
![]()
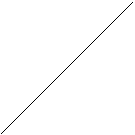
![]()
 . . .
. . .
. . .
. . .
Comment
sortir de ses propres règles
Cependant s’il est facile,
après coup, pour l’individu qui résout l’énigme d’accepter que rien dans
l’énoncé ne présuppose en effet qu’il faille à tout prix rester à l’intérieur
du carré imaginaire, les règles dans lesquelles chacun s’enferme, qui résultent
des croyances qu’il s’est progressivement construites et qui revêtent à ses
yeux une apparence de réalité, les choses se compliquent. «Leur recette,
consistant à faire plus de la même chose est une solution qui crée le problème. »
op.cit
Le protagoniste «ne peut
supporter l’idée que ses prémisses soient en défaut, car, pour lui, elles
constituent la vérité, la réalité». «Il est capital de bien marquer cette
distinction entre, d’une part, les faits, d’autre part, les prémisses concernant
les faits pour comprendre les vicissitudes du changement. » op.cit Ainsi souvent : «ce n’est pas la
manière dont les choses sont réellement qui constitue le problème et qui doit
être changée, mais la prémisse selon laquelle les choses devraient être d’une
certaine façon.» op.cit
Selon les auteurs l’action
qui permet le changement est décisive lorsqu’elle s’applique à ce qui est fait
pour régler la difficulté et non pas à la difficulté elle-même. Déjà, Epictète,
au premier siècle après Jésus Christ, disait : «Ce ne sont pas les choses
qui troublent les hommes mais l’opinion qu’ils en ont.» «Si quelqu’un parvient à connaître une
théorie sur son comportement, il ne lui est plus soumis, mais il acquiert la liberté
de lui désobéir» Howard “Paradoxes of rationality” MIT
Press Cambridge (Massachusetts) and London, 1971 p XX.
Extrait de «Astuces
pour conduire, accompagner et mieux vivre le changement» - Arlette Yatchinovsky à paraître aux
éditions ESF
D) Des outils & méthodes pour apprendre à apprendre
1) ACIM ou Activités Cognitives et Images Mathématiques - Henri Planchon Edition EAP - 1990
Extrait de la Base ressource du CRI
de la région PACA
http://illettrisme.org/res_liste.php?mot=Educabilit%E9%20cognitive
Complément
de titre : Educabilité cognitive ou apprendre à penser. Formation continue.
Livre du formateur. Méthode A.C.I.M.
Objectif :
Donner à des jeunes ou à des adultes les moyens d'assimiler et d'organiser un certain
nombre de savoirs et savoir-faire articulables à la vie quotidienne et
professionnelle, et, en même temps, les conduire à réaménager leur rapport aux
mathématiques. Cela en adoptant les modalités d'intervention respectueuses de
leur statut d'adulte. La méthode ACIM se veut plus qu'une formation en
mathématiques, mais également une formation par les mathématiques, tendue vers
le développement et l'autonomie de la personne.
Contenu :
Ce manuel
destiné aux formateurs décrit les différentes modalités d'utilisation des
différents modules qui constituent la méthode A.C.I.M. dont l'objectif n'est
pas uniquement de transmettre des savoirs en mathématiques mais de favoriser
l'autonomie de l'apprenant par rapport à l'acquisition des connaissances. Après
une description générale de la méthode figurent les 16 dossiers qui regroupent
les différents modules. Les modules sont des planches présentant des problèmes
apparemment complexes mais sur lesquels chacun peut engager une activité à son
niveau. Ceux-ci mettent l'accent sur les procédures liées au raisonnement, au
traitement de l'information, et à la résolution de problèmes arithmétiques et
géométriques.
Chacun des
modules peut être exploité sur une ou plusieurs séances. Le nombre et le choix
des modules est fonction du public auquel on s'adresse, des objectifs qu'on se
propose d'atteindre, du temps dont on dispose. La durée minimum de ce type de
formation est de 20 heures environ. Le travail sur les modules peut se dérouler
en situation individuelle ou collective.
Le fond
théorique de la méthode est la psychologie cognitive, au carrefour des concepts
de Wittgenstein, Vygotsky, Bateson, E. Morin et Bion. Approche systémique.
Mots-Clés
: Educabilité cognitive / Géométrie / Mathématiques / Arithmétique / Apprentissage
travail autonome / Méthode pédagogique
2)
ACTIVOLOG ou Atelier d’activation du raisonnement logique
Concepteurs : G. Chazot et E. Perry MPS
de Grenoble Maison de la promotion
sociale - Domaine universitaire - 38406 Saint-Martin-d’Hères
Sources d’informations :
-
Extraits du livret formateur
(pp. 1 à 34)
-
Catalogue du « Quatre A
Deux I » (groupe national pour la formation professionnelle) distribué au
FAS 1988
-
Entretien avec Stanislas
Mackiewiocz
Contexte
d’émergence :
Dès 1970
émerge chez les auteurs le souci de privilégier les « soubassements
cognitifs » dans la formation de « publics faibles » par
l’introduction d’activités « d’initiation logique et de calcul » dans
les stages de préformation professionnelle. Puis, pour s’adapter à ces nouveaux
publics, la MPS crée un « outil d’activation et de développement du
raisonnement logique » : ACTIVOLOG, qui permet de prendre en compte
le fonctionnement cognitif des formés. Apprendre c’est comprendre : ce qui
permet de comprendre relève toujours d’un même ensemble « d’outils de
connaissance », peu nombreux, mais dont seuls les degrés d’élaboration et
de coordination conditionnent l’efficience. ACTIVOLOG se présente comme un
instrument de développement des capacités à comprendre.
Références
théoriques explicites :
-
Inspirée
des travaux de Piaget sur le développement de l’intelligence et de
l’épistémologie génétique.
-
Pédagogie
de la réussite : primat de la démarche pour trouver la solution.
-
Registres
de fonctionnement P. VERMEERSCH : apport de Vermeersch par rapport à la
théorie piagétienne des stades.
-
Les
travaux de Doise et Mugny et de Perret-Clermont sur le conflit socio-cognitif.
Publics
ciblés :
ACTIVOLOG
est accessible à tous les personnels confrontés à l’introduction de nouvelles
technologies, ou à un changement d’organisation du travail, à des reconversions
(ouvriers, employés et personnels des hiérarchies intermédiaires). Niveau
scolaire minimum : fin d’études primaires.
Pré-requis :
maîtrise de la lecture, des structures pré-opératoires et opératoires
concrètes.
L’ensemble
pédagogique s’adresse aux personnes présentant des difficultés d’adaptation ou
de réadaptation d’ordre cognitif ou manifestant une mobilité restreinte des
opérations formelles, ainsi qu’aux personnes souhaitant s’entraîner sur des
supports d’exercices variés. Sont toutefois exclus les publics dits de faible
fonctionnement intellectuel (registre concret ou pré-opératoire). Les auteurs
renvoient la prise en charge de ce type de public aux ARL.
Objectifs
poursuivis :
En
atelier :
- Favoriser l’adaptation des
personnes en augmentant leurs compétences cognitives ou intellectuelles.
- Réactiver les registres
intermédiaire et formel par une mise en situation spécifique.
- Restructurer individuellement
les compétences cognitives mises en jeu par chacun.
- Favoriser la généralisation et
le transfert de ces compétences cognitives en situation professionnelle.
En
auto-formation : permettre un entraînement des capacités mentales.
ANNEXES
- Ed. RETZ
« Au cœur de la formation » La pédagogie en mouvement : Guide
des méthodes et pratiques en formation. Les applications 3. Les outils de
remédiation cognitive – Edmond MARC (p39 à 40). Tableau comparatif :
Présentation de quelques méthodes d’éducabilité cognitive (p42 à 43).
- Ed.
Sciences humaines Eduquer et former dirigé par Jean-Claude BUANO-BORBALAN (p129
à 135 – Tableau comparatif).
- Apprendre
à raisonner, apprendre à penser – Marcel GIRY
Ed. Hachette Education Petit glossaire de la gestion mentale : p165
- Ed.
l’Harmattan Pratiques nouvelles en éducation et en formation
L’éducabilité
cognitive Sous la direction de Maryvonne SOREL
http://perso.wanadoo.fr/activolog/html/cadre100.html
Contact : MPS-FORMATION 580, rue des Universités
- 38406 SAINT-MARTIN D’HERES - Tél. 04 76 42 07 27 - Fax 04 76 44 15 59e-mail :
mps.formation@wanadoo.fr
3) ARL - HIGELE Pierre, HOMMAGE Gérard &
PERRY Elisabeth - CAFOC de Nancy Metz - 1992
Extrait de la Base ressource du CRI de la région PACA
http://illettrisme.org/res_liste.php?mot=Educabilit%E9%20cognitive
Livret du
stagiaire. Il fait partie d'une mallette comprenant aussi le livret du
formateur. Présentation des aspects théoriques et pratiques de la méthode des
ateliers de raisonnement logique (ARL), méthode pédagogique offrant une
progression d'exercices destinés à mobiliser les potentialités logiques des
apprenants. Fiches d'exercices et solutions.
Mots-Clés : Educabilité cognitive /
Atelier raisonnement logique / Raisonnement logique / Outil pédagogique
4) AXIOS
Axios
est une méthodologie pour apprendre à apprendre qui a été crée en 1994 par ACEREP.
La demande a émergé des entreprises qui souhaitaient avoir à leur disposition
une méthode similaire à Tanagra mais qui réponde plus particulièrement aux
besoins des agents de maîtrise.
En
effet, les agents de maîtrise, tout comme les membres de leurs équipes,
ressentaient la nécessité d’être plus armés en termes d’outils pour faire face
aux situations nouvelles auxquelles ils étaient confrontés. Cependant que leurs
problèmes se doublaient du besoin d’accompagner leurs collaborateurs face à la
résolution de problèmes nouveaux.
Ainsi, ACEREP a décidé de
bâtir une méthodologie composée de deux séquences :
-
Le matin, l’analyse d’une situation problème
-
L’après-midi, une séquence consacrée à la communication.
Les outils utilisés pour
l’analyse des situations/problèmes proposées, sont des outils qui facilitent
l’analyse de l’information, la décomposition en étapes et l’utilisation de
représentations graphiques. Ils s’inspirent de la pensée de Jean Piaget, et
reprennent des idées développées dans les Ateliers de Raisonnement Logique et
dans Tanagra. (Tableaux à double entrée, ordinogrammes, diagrammes,
arborescence,… etc.)
Les exercices liés à la
nécessité des chefs d’équipe de communiquer les résultats de leur analyse et de
les faire partager à leurs collaborateurs, sont des outils sur la communication
inter personnelle et la connaissance de soi. Ils sont davantage laissés à
l’appréciation de l’animateur en fonction des besoins spécifiques des
apprenants.
Ils peuvent, par exemple,
découler de leur peur de perte de pouvoir quant à leur rôle technique ou
émerger face à leur difficulté à identifier les nouvelles capacités qui sont
attendues d’eux.
5) CUBE de
MIALET
Concepteur : Pierre Mialet (1986) Responsable de la
formation : André Salle
Sources d’informations : Entretiens avec Pierre Mialet et André Salle,
Notes d’André Salle, Documents internes à la Somaford, & Article d’André
Salle dans la revue « Formation continue et développement des
organisations »
Contexte
d’émergence :
L’analyse
des conséquences du taylorisme industriel met l’accent sur la rupture
conception/exécution. Pourtant, il est courant aujourd’hui dans l’entreprise de
vouloir confier à des « mécaniciens de premier échelon de maintenance
et des interventions courantes sur les éléments simple d’une machine ».
Par ailleurs les caractéristiques actuelles de la vie au travail (abstraction
croissante des tâches liées à des procédés automatiques) impliquent une
évolution des attitudes cognitives au travail, c’est-à-dire la nécessité d’accroître
les capacités de raisonnement, d’analyse et de déduction, de faciliter la
relation entre l’homme et les symboles et donc de développer les structures
logico-mathématiques.
Née de
« l’intuition » que les mathématiques et la logique
deviendraient des outils essentiels dans le monde du travail, la méthode des
cubes a été inventée et brevetée par Pierre Mialet (ingénieur et psychologue)
en 1979. Elle a d’abord été utilisée dans des sessions de formations « cadres ».
L’objectif était alors de « développer le potentiel créatif des
dirigeants, des chercheurs ». Elle a été expérimentée dans plusieurs
grands groupes industriels progressivement. Et parce que le problème des
mutations technologiques est devenu un problème majeur, elle est surtout
« employée aujourd’hui comme outil de développement cognitif à l’usage des
opérateurs de production ou des employés de bureau confrontés aux mutations
technologiques » en tant qu’outil facilitateur des apprentissages
logiques. Mais, de manière originale, cette méthode a comme projet « d’apprendre
à apprendre tout en apprenant quelque chose ».
Références
théoriques de la méthode [5]:
q Les travaux de Jean Piaget
concernant la théorie opératoire de l’intelligence, notamment la mise en place
des structures opératoires de l’intelligence formelle, mais aussi les
réflexions plus récentes de Jean Piaget à propos de l’inconscient cognitif
(1972).
q Les travaux de H. Poincarré sur
« l’inconscient logico-cognitif ».
q Une théorie personnelle de Pierre
Mialet à propos de l’inconscient logico-cognitif, s’appuyant notamment sur le
traitement des opérateurs logiques au moyen des nombres de Fermat.
q Les travaux du linguiste américain
Noam Chomsky concernant les grammaires formelles, la logique symbolique et la
linguistique algébrique.
q Les travaux du logicien allemand
Frege (1899) concernant la théorie de « l’Ancestral », reprise par le
logicien britannique Russel.
Le problème
de l’apprentissage est subordonné au problème que pose le fonctionnement de
l’inconscient logico-cognitif supposé renfermer les « lois de la
pensée » de Georges Boole (P. Mialet, 1988).
Publics
ciblés :
Des
ingénieurs aux opérateurs de production, c’est-à-dire les techniciens, les
agents de bureau, les cadres commerciaux… salariés dans des entreprises :
-
qui
automatisent leurs moyens de production et ont besoin d’un personnel mieux
formé dans les « sciences dures » ;
-
qui
développent des démarches de qualité ;
-
qui
s’engagent dans une politique de requalification (remise à niveau).
La méthode
est inaccessible à des personnes qui ne maîtriseraient pas es compétences de
base (lire, écrire, compter) et qui de manière générale auraient un niveau
général inférieur à celui d’une cinquième de collège.
Objectifs
poursuivis :
« Sous
peine de devenir les « robots du robot », il faudra que les
opérateurs comprennent les principes de base qui sous-tendent la conception et
le fonctionnement des machines qu’ils utilisent : « Aider les adultes
à accéder au raisonnement mathématiques et logique, c’est ouvrir l’accès aux sciences
dures » (P. Mialet – 1988). Ces principes reposent assez précisément
sur l’arithmétique binaire et les codes correspondants, ainsi que sur l’algèbre
de Boole.
Pour cela
la méthode des cubes se propose de :
-
Dédramatiser
les mathématiques : « Puisque les mathématiques sont partout, dans
notre propre inconscient, dans la nature, dans les objets qui nous entourent et
en particuliers dans l’électronique et les automatismes, il n’y a pas de raison
d’en avoir peur. » Pour cela il faut pouvoir accéder à l’usage banalisé de
l’arithmétique et de l’algèbre, de la combinatoire, des probabilités, du calcul
booléen, et les considérer comme des outils de pensée commodes pour appréhender
le réel.
-
Restituer
la dimension culturelle des mathématiques : « les mathématiques sont un
produit de l’histoire de l’humanité. Elles n’ont rien d’un ensemble tout à fait
intemporel et désincarné, comme le laisseraient croire les manuels
scolaires ! Derrière chaque concept, il y a des noms d’hommes, des
découvertes, des affrontements, des coïncidences. Les liens entre la
psychologie, les mathématiques, les sciences de la vie sont constants dans
l’histoire. »
-
Pour
cela il fait remplacer les mathématiques dans leur évolution vécue et dans
leurs relations avec les autres expressions de la pensée et de la connaissance.
-
Donner
un aperçu global des mathématiques : « L’avance fragmentaire des
mathématiques (dans la progression scolaire) qui fait le champ d’ensemble des
mathématiques n’est connu que de ceux qui poursuivent leurs études supérieures…
Cette situation… renforce la présomption d’ésotérisme des mathématiques ».
Pour faciliter l’accès aux mathématiques, il faut donner un sens à leur
apprentissage ; en comprendre l’étendue, la cohérence et la diversité.
-
Favoriser
le développement personnel et réveiller une curiosité intellectuelle, l’envie
d’apprendre, le goût pour les concepts et la pensée abstraite.
Synthèse
La
spécificité de la méthode des cubes de Mialet est la transmission d’un contenu
de connaissances logico-mathématiques clairement identifiable, au cœur de la
compréhension des « nouvelles technologies ».
En effet,
qu’il s’agisse de former à l’informatique ou à la bureautique, des
connaissances de base sont requises parmi lesquelles on situera, en
autres :
-
la
connaissance des bases de l’algèbre, des opérateurs logiques.
Ces
connaissances ne sont pas évidentes à acquérir, surtout pour des personnes ne
possédant pas ou peu de connaissances théoriques de base et ayant exercé de
surcroît un métier répétitif pendant quinze ou vingt ans sans avoir eu
l’occasion de revenir en formation. Comment les faire accéder « en
douceur » aux abstractions du monde mathématique ? Dans ce contexte,
intervient cette méthode.
A partir
d’un support constitué de cubes, le stagiaire va d’abord construire son arbre
généalogique ascendant, les fonctions parentales étant représentées par des
cubes « M » (pour la relation de maternité) et « P » (pour
paternité). Les fonctions parentales correspondant aux 2ème, 3ème
et 4ème générations supposent, pour être représentées, de concaténer
les cubes M et ce dans l’ordre
voulu : il s’agit d’un exercice mettant en jeu la logique combinatoire à
partir d’un schéma universel (nos Ancêtres et la reproduction sexuée).
Au fil de la formation, le stagiaire sera conduit à manipuler les cubes, à les retourner à les regrouper, etc. A partir des symboles inscrits sur les différentes faces des cubes, il découvrira successivement le triangle de Pascal et ses applications arithmétiques, les bases de numération binaire, octale et hexadécimale, le binôme de Newton, puis l’algèbre de Boole et les seize opérateurs de la logique propositionnelle.
Les
fonctions logiques étant les « briques élémentaires » des automates
et des ordinateurs, les contenus de connaissance évoqués ci-dessus constituent
la culture générale de base que toute personne doit posséder pour s’intégrer
dans le monde des nouvelles technologies, au même titre qu’il fallait savoir
lire, écrire et compter pour s’intégrer dans le monde du XXe siècle.
C’est bien la raison essentielle pour laquelle la notion d’éducabilité
cognitive commence à être à la mode dans l’entreprise, au-delà des problèmes de
psychologie et de développement personnel…
6)
ORPHEE
ou comment apprendre à gérer l’incertitude et la
complexité ?
Face
à l’incertitude et la complexité croissantes qui engendrent une impossibilité
de décider à long terme et même à moyen terme, les responsables tous comme les
autres publics, éprouvent des difficultés pour décider et passer à l’action.
Notre méthodologie, basée sur l’approche systémique, a pour but de leur
apprendre à penser différemment. C’est la raison pour laquelle nous pensons
qu’elle relève de l’apprendre à apprendre.
Les
exercices ont été construits pour mettre en lumière les quatre préceptes de
l’approche systémique. Ils ont pour objectif, au cours d’une séquence qui suit
chacun d’entre eux, de permettre aux apprenants de mettre à jour leurs
croyances, ainsi que leurs propres représentations. Le but étant de les aider à
trouver de nouvelles solutions plus adaptées au contexte actuel.
-
Le premier précepte qui doit permettre à chacun de regarder les choses
différemment nous dit que la réalité n’existe qu’à travers la perception de
celui qui la regarde, en fonction de ses intentions et ses enjeux. Ainsi
l’apprenant devient l’observateur qui va apprendre à apprendre à regarder la
réalité selon divers points de vue et à se décentrer de son point de vue
unique.
- Le deuxième précepte, de l’approche systémique, est de
ne jamais regarder un problème sans le replonger dans un plus grand tout.
Chaque apprenant apprendra ainsi à ne pas se centrer uniquement sur ce qui lui
apparaît problématique, mais à mettre en lien tous les éléments et tous les
facteurs avec lesquels son problème a des interactions. Cette analyse lui apprendra
à ne pas rester campé sur ses positions,
dans le but d’identifier des pistes d’actions et des sources
d’informations nouvelles ainsi que des partenaires potentiels sur lesquels il
pourra s’appuyer.
-
Le troisième précepte apprendra à l’apprenant à évoluer en comprenant que tout
comportement est pertinent par rapport à un projet : le sien et celui des
autres. Ce précepte met en lumière sa place de décideur face à son futur. Il
apprendra, de ce fait, qu’il peut mobiliser un ensemble de ressources pour
atteindre son but. D’une place de quelqu’un qui subit, il apprendra à devenir
acteur de son propre devenir.
-
Enfin, le quatrième précepte est d’accepter que face à la complexité et
l’incertitude, il est illusoire de vouloir recenser de façon exhaustive tous
les facteurs à considérer. Ce précepte devrait permettre à l’apprenant
d’apprendre à agir sans tout maîtriser, l’essentiel étant d’avancer.
Ces quatre préceptes qui
sont les préceptes complémentaires du Discours de la Méthode de Descartes nous
semblent relever de l’apprendre à apprendre dans la mesure où ils représentent
un renversement de perspective par rapport à nos pratiques habituelles. Il ne
s’agit pas de remplacer nos pratiques cartésiennes, il s’agit de les compléter
par un autre regard.
Référence :
«L’approche systémique pour gérer l’incertitude et la complexité» - Arlette
Yatchinovsky - ESF éditeur
7) TANAGRA
ou comment apprendre à changer ?
Module pédagogique
d’entraînement au raisonnement logique, ciblé sur les capacités d’adaptation, TANAGRA s’inscrit dans un processus de
mobilisation et de dynamisation des personnes, afin de leur permettre de faire
face et de répondre de manière efficace aux impératifs d’évolution et de
changements, aussi bien technologiques que structurels ou organisationnels,
dans l’entreprise.
TANAGRA
repose sur le pari ambitieux, mais régulièrement tenu que :
-
Le niveau de raisonnement logique,
-
Le goût de la réflexion avant l’action,
-
les possibilités de communication,
-
et la confiance en soi
de tout adulte motivé
peuvent être améliorés en quelques journées de travail intensif et
rigoureusement ciblé.
L’objet du module TANAGRA
n’est pas de communiquer un savoir ni un savoir faire, mais un savoir analyser.
TANAGRA
permet :
-
d’améliorer les aptitudes individuelles et les attitudes globales de chacun,
-
d’aborder sans craintes les problèmes logiques,
-
d’identifier les blocages et de les dépasser,
-
de développer la capacité à analyser,
-
de structurer la pensée avec des arguments.
II) Apprendre à apprendre et le multimédia
2.A) Exploitation de la base « Ressources » d’Algora
1)
RESSOURCES : SCIENCES DE L’EDUCATION
APPRENDRE A APPRENDRE : ILLUSION...OU NECESSITE ?
Type : Vidéo Contenu : La cassette vidéo a été constituée lors de le conférence
organisée par B.Lahorgue-Poulot en mai 1993 au Futuroscope sur le thème - A
quoi sert l'école - où l'on tente de répondre à la question... "et nous,
enseignants, à quoi sert-on ?". Support
: VHS - Auteur : Mérieu PH.- Mots
clés : Sciences de l'éducation - Durée
: 2 heures - Prix version unitaire :
22.87
Distribué par : CNDP - DISTRIBUTION 13-15 bd d'Italie 77568
LIEUSAINT CEDEX -T. 01 64 88 46 29 -
COMMENT ON APPREND ?
Type : Vidéo Contenu : Jean Berbaum, Maître de Conférences à l'Université
de Lyon, s'interroge depuis plusieurs années sur les processus d'apprentissage
à l'école et chez les adultes. En soulignant particulièrement les notions de
projet professionnel, de situation d'apprentissage, de traitement et de saisie
de l'information, de mémorisation et d'expression, il invite les formateurs et
les enseignants à porter un autre regard sur des questions auxquelles ils sont
confrontés. Support : VHS Mots clés : Sciences de
l'éducation/Formation de formateurs - Durée
: 56 mn - Prix version unitaire :
22.87 Euros
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2
T. 02 51 25 07 25
- F. 02 51 25 07 20
ESPOIRS ET ILLUSIONS DE LA MESURE
Type : Vidéo Contenu : Cette émission traite de la mesure, de la recherche de
rationalité dans diverses pratiques évaluatives. Dans le domaine de la
formation, est abordée plus particulièrement la question de la notation. Les
progrès de la mesure ont joué un rôle essentiel dans l'évaluation des sciences
et des techniques. En est-il de même dans les techniques de l'éducation ? Support : VHS - Mots clés : Formation/Sciences de l'éducation - Durée : 55 mn. Prix version unitaire : 22.87 Euros
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2 - T. 02 51 25 07
25 - F. 02 51 25 07 20
EVALUER L'EVALUATION
Type : Vidéo Contenu : Examen critique de l'évaluation telle qu'elle est
pratiquée dans le domaine de l'éducation, de l'économie et de la politique.
Trois domaines d'ailleurs étroitement liés. L'évaluation n'est pas une affaire
d'experts : c'est souvent ce qui est en marge qui est le plus intéressant. Il
n'y aura donc pas de recettes, mais c'est à chacun de faire sa propre démarche
évaluative. Support : VHS Mots clés : Sciences de
l'éducation - Durée : 55 minutes - Prix
version unitaire : 22.87 Euros.
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2 - T. 02 51 25 07 25 -
F. 02 51 25 07 20
HISTOIRE ET PROJET
Type : Vidéo Contenu : Ce film, qui fait partie d'une série de huit émissions
sur le thème de la Pédagogie du projet, se définit pour le formateur par des
histoires de vie. Cette série propose à partir d'interviews spontanés, un
carrefour des pratiques en formation en passant par une présentation des grands
problèmes théoriques et méthodologiques de ce courant socio-éducatif. Dans ce
film il s'agit d'aborder de manière synthétique et aussi simple que possible
les grandes questions d'ordre épistémologique qui se posent dans ce courant.
Les questions relatives à l'historicité et au projet sont ici abordés. Support : VHS Mots clés : Formation/Formation de formateurs/Sciences de
l'éducation - Durée : 55 minutes - Prix version unitaire : 22.87
Euros.
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2 - T. 02 51 25 07 25 -
F. 02 51 25 07 20
L'HABITUS
Type : Vidéo Contenu : Le développement accéléré des mutations technologiques,
économiques, sociales et culturelles, implique pour chacun la nécessité
d'augmenter ses capacités et ses connaissances pour comprendre et apprendre de
façon autonome et individualisée. Cette réussite, possible pour tous, passe
pour chacun par la prise en compte de l'expression de son projet et la mise en
oeuvre d'une pédagogie différenciée dans laquelle les apprentissages
individualisés ont une place désormais essentielle. Dans le cadre du DESS
Stratégie et Ingénierie de la Formation, le professeur Marcel Lesne nous
propose une approche sociologique d'une théorie de l'éducation axée sur le concept
de l'habitus. Support : VHS - Mots clés : Sciences de l'éducation
- Durée
: 56 mn - Prix version unitaire :
22.87 Euros.
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2 - T. 02 51 25 07 25 -
F. 02 51 25 07 20
LES GRANDS CONCEPTS DE
L'EVALUATION
Type : Vidéo Contenu : Rien n'est aussi pratique qu'une bonne théorie écrivait
le fondateur de la psychosociologie, Kurt Lewin. Qu'il s'agisse de tester un
médicament, de fabriquer un instrument de musique, de choisir une
interprétation, on doit distinguer entre les procédures de vérification et de
contrôle d'un objet ou d'une action et les processus d'appréciation de la
valeur et du sens de cet objet ou de cette action. Mais dans un cas comme dans
l'autre on a besoin de critères pour juger, et d'indicateurs pour analyser la
réalité. Support : VHS - Mots clés : Sciences de l'éducation - Durée : 55 minutes - Prix version unitaire : 22.87
Euros.
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2 - T. 02 51 25 07 25 -
F. 02 51 25 07 20
NE POUR CHOISIR
Type : Vidéo
Objectif : Aborder l'une des sept
étapes de l'acte d'apprendre autour d'un entretien avec une personnalité du
monde scientifique (Albert Jacquard, généticien mathématicien et André
de Peretti, psychosociologue). Contenu
: L'enfermement dans un projet dont l'objectif a été imposé n'appartient pas à
la dynamique du vivant. S'engager pour s'approprier son projet permet d'assurer
le besoin existentiel de relier son contexte à son système de valeurs (au nom
de quoi je construis ?). Etape essentielle dans un parcours éducatif et de
formation. Support : VHS - Mots clés : Sciences de l'éducation - Durée : 28 mn - Prix version unitaire : 45.74 Euros.
Collection «Né pour ….» Distribué par : ENS EDITION
15, parvis René Descartes 69007
LYON T. 04 37 37 60 95 - F.
04 37 37 60 96
NE POUR CREER DU SENS
Type : Vidéo Objectif : Aborder l'une des sept étapes de l'acte d'apprendre
autour d'un entretien avec une personnalité du monde scientifique (Francisco
Varela, biologiste). Contenu :
Tout ce que nous percevons, pensons, imaginons est biographique, c'est-à-dire
résulte de notre couplage avec l'environnement. L'information n'existe pas en
soi. Nous devons recadrer notre langage, repenser l'autonomie. Le moteur de
notre logique de connaissance est notre capacité de sélection et de décision.
Un horizon nouveau s'ouvre.
Support : VHS Mots clés : Sciences de l'éducation - Durée : 28 mn - Prix version
unitaire : 45.74 Euros
NE POUR DECOUVRIR
Type : Vidéo Objectif : Aborder l'une des sept étapes de l'acte d'apprendre
autour d'un entretien avec une personnalité du monde scientifique (Boris
Cyrulnik, étho-psychiâtre). Contenu
: Le savoir-observer : voir, entendre, toucher, se mouvoir, exister dans notre
environnement... Apprendre à éviter les certitudes bien ancrées, la
contextualisation forcenée et la focalisation excessive. Support : VHS - Mots clés
: Sciences de l'éducation - Durée :
25 mn - Prix version unitaire :
45.74 Euros.
NE POUR ECHANGER
Type : Vidéo Objectif : Aborder l'une des sept étapes de l'acte d'apprendre
autour d'un entretien avec une personnalité du monde scientifique (Bertrand
Schwartz, insertion professionnelle des jeunes). Contenu : Equilibrer l'axe donner-recevoir dans l'apprentissage et
la communication ; garantir le temps de questionnement, d'intégration, de
participation, de responsabilisation ; assurer l'espace du dialogue entre les
acteurs de la situation éducative. C'est la démarche proposée à partir
d'expériences vécues avec des jeunes qui découvrent que la qualification se
construit au cours de l'action et dans l'échange. Support : VHS - Mots clés : Sciences de l'éducation - Durée : 45 mn - Prix version unitaire : 45.74 Euros.
NE POUR INNOVER
Type : Vidéo Objectif : Aborder l'une des sept étapes de l'acte d'apprendre
autour d'un entretien avec une personnalité du monde scientifique (Didier
Vincent, neuro-endocrinologue et G. Brunon, J-P Augier, S. Desplats, C.
Maestri). Contenu : Savoir créer,
c'est utiliser les capacités fondamentales de notre cerveau : connectivité,
sélectivité, flexibilité, complémentarité,
rythmes etc. Support : VHS - Mots clés : Sciences de
l'éducation - Durée : 40 mn - Prix version
unitaire : 45.74 Euros.
NE POUR ORGANISER
Type : Vidéo Objectif : Aborder l'une des sept étapes de l'acte d'apprendre
autour d'un entretien avec une personnalité du monde scientifique (Francisco
Varela, biologiste). Contenu : Le
savoir-organiser (sélectionner, classer, comparer, généraliser, abstraire et
coder...) est une exigence biologique de notre cerveau. On ne peut enfermer
l'humain dans une conception linéaire, causaliste, symétrique sans risquer de
le priver de son immense potentiel de connectivité, de flexibilité, et de
mémoire. Support : VHS - Mots clés : Sciences de l'éducation - Durée : 25 mn - Prix version unitaire : 45.74 Euros.
NE POUR RECONNAITRE LES LOIS DE LA
VIE
Type : Vidéo Objectif : Aborder l'une des sept étapes de l'acte d'apprendre
autour d'un entretien avec une personnalité du monde scientifique (Basarab
Nicolescu, physicien théoricien). Contenu
: Les lois du vivant et le contexte dans lequel la vie est apparue, en
particulier la complexité, l'hétérogénéité, l'évolution, les rythmes etc. Support : VHS Mots clés : Sciences de l'éducation Durée : 30 mn Prix version
unitaire : 45.74 Euros.
PEDAGOGIE DE LA LECTURE
Type : Logiciel Objectif : Présenter à la communauté éducative un ensemble
d'informations sur la pédagogie de la lecture de la maternelle à la sixième. Contenu : Le cédérom est organisé en 5
chapitres.
- Le
premier relate des expériences et des actions conduites dans toutes les
académies. 177 dossiers analysent des pratiques pédagogiques centrées sur
l'apprentissage de la lecture, décrivent des activités diversifiées, visent à
développer la maîtrise de la langue et le goût de lire et d'écrire, à
promouvoir le livre, et rendent compte d'actions de formation des enseignants
et d'information en direction des familles. Les expériences décrites
s'inscrivent dans un projet d'école ou d'établissement. Elles sont le fait
d'une équipe éducative pour les écoles ou pluridisciplinaires pour les
collèges, associant souvent des partenaires extérieurs (parents, écrivains,
artistes) et débouchent sur une production (album, roman, dictionnaire, etc.).
- Le deuxième chapitre présente des textes de chercheurs. Il
comprend 104 articles (essais, synthèses...) qui apportent l'éclairage
théorique aux dossiers pédagogiques du premier chapitre.
- Le
troisième propose un recueil de textes officiels de 1791 à 1995, plaçant dans
une perspective historique les recommandations sur la lecture et sur la
maîtrise de la langue. On y trouve les grands noms de l'histoire pédagogique de
notre pays, auxquels est généralement associée une courte notice biographique.
-
Le
quatrième comprend près de 1500 références documentaires : elles concernent les
ouvrages, articles et travaux spécialisés, les logiciels éducatifs et la
littérature de jeunesse. 1001 livres de littérature enfantine, sélectionnés par
un groupe de travail de la Direction des écoles, sont repris en fiche classés
par thèmes et par niveaux d'âge.
-
Le
cinquième chapitre, enfin, donne un accès direct aux audiogrammes et
vidéogrammes présents dans la banque de données.
Support : CD-Rom - Mots clés : Sciences de l'éducation/Lecture - Editeur : CNDP - Prix
version unitaire : Contacter
le CNDP - Distribué par : CNDP - DISTRIBUTION 13-15 bd d'Italie 77568 LIEUSAINT
CEDEX T. 01 64 88 46 29 -
TROIS PRATIQUES DE TERRAIN
Type : Vidéo Contenu : Ce film fait partie d'une série de huit émissions sur le
thème de la Pédagogie du projet, et se définit pour le formateur par des
histoires de vie. Après s'être orienté dans le champ des pratiques, il convient
d'en visiter quelques unes sur le terrain et ce, de manière plus approfondie.
De voir ce que cela représente concrètement, en situant toujours le cadre
général où, quand, comment, avec qui et dans quel objectif ? Support : VHS - Mots clés : Formation/Formation de formateurs/Sciences de
l'éducation - Durée : 55 mn - Prix
version unitaire : 22.87 Euros.
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2 - T. 02 51 25 07 25 -
F. 02 51 25 07 20
UNE RELATION HUMAINE DIFFICILE
Type : Vidéo Contenu : Nous sommes tous en attente d'évaluation. Il y a dans
toute évaluation une relation avec l'autre : relation de séduction, d'autorité
ou de sanction, etc... L'évaluation doit nous permettre d'être des individus
responsables que ce soit dans le domaine de l'éducation ou de l'entreprise. Support : VHS Mots clés : Sciences de l'éducation/Formation de formateurs - Durée : 55 minutes - Prix version unitaire : 22.87
Euros.
Distribué par : UNIVERSITE NANTES PRODUCTION - CENTRE
MULTIMEDIA Ateliers et chantiers de Nantes - 2 bis, bd Léon Bureau - BP 96228
44262 NANTES CEDEX 2 - T. 02 51 25 07
25 - F. 02 51 25 07 20
TECHNIQUES DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
COMMENT MIEUX COMMUNIQUER AVEC SON
CERVEAU
Type : Vidéo Objectif : Apprendre à mieux communiquer avec les autres, et à
déterminer sa préférence cérébrale. Contenu
: Après avoir expliqué les fonctions du cerveau droit et celles du cerveau
gauche, le cerveau reptilien limbique ou cortical, Dominique Chalvin propose à
chacun de déterminer sa préférence cérébrale. Après cette auto-analyse, il
donne les moyens de mieux communiquer avec les autres.
Support : VHS - Mots clés : Technique de développement personnel/Savoir communiquer
- Durée : 50 mn. - Prix version unitaire : 130.00
Euros. Distribué par : IMAGES POUR LA FORMATION 15 avenue de Ségur 75007
PARIS - T. 01 45 55 89 00 - F. 01 45 56 19 14
CONSEILS ET METHODES POUR MIEUX
APPRENDRE
Type : Vidéo Objectif : Conseiller afin de mieux apprendre. Contenu : Techniques d'aide à la compréhension et à la mémorisation
des cours. Support : VHS - Niveau : III/IV - Mots clés : Technique de développement personnel - Durée : 105 mn Editeur : CNED - Prix
version unitaire : 15.00 Euros.
Distribué par : CNED BP 60200 86980 FUTUROSCOPE CEDEX T. 05 49 49 94 94 - F. 05 49 49 96 96
STIM GNOSIA - MEMOIRE 01
Type : Logiciel Objectif : Outil de stimulation cognitive pour apprenant en
difficulté d'apprentissage. Contenu
: StimGnosia est une collection d'outils qui s'inscrit comme une entité
spécifique, intégrant un projet global lié au suivi de personnes en difficulté
d'apprentissage. MEMOIRE 1, comme son nom l'indique, est le premier volet d'une
série d'applications ayant pour objectif
un apprentissage, en vue d'une restitution mnésique. - Sollicitation des
fonctions cognitives - Sollicitation d'opérations mentales élémentaires - Stimulation
des capacités d'attention / concentration - Stimulation à l'utilisation de
l'auto-évaluation - Stimulation aux fonctions méta cognitives - Stimulation à
l'autonomie cognitive et l'autonomie sociale MEMOIRE 1 se décline en deux
versions.
La version pour les familles : L'application est conçue pour
répondre aux besoins d'un apprenant en difficulté d'apprentissage afin qu'il
puisse entretenir à domicile des sollicitations cognitives à travers
l'apprentissage de listes de mots, de la restitution et de l'auto évaluation de
ces listes de mots.
La version pour les institutions. L'application répond à
l'utilisation de plusieurs apprenants dans les mêmes cadres de performances.
Support : CD-Rom - Mots clés : Technique de développement personnel/Illettrisme - Editeur : ITEMS MEDIA CONCEPT - Prix version unitaire : 49.00
Euros.
Distribué par : ITEMS MEDIA CONCEPT
70, quai de Paludate 33800 BORDEAUX -
T. 05 57 35 73 73 - F. 05 57 35 73 70
2) RESSOURCES :
RAISONNEMENT LOGIQUE
ASSIMO : MATHEMATIQUES
Logiciel
- 1 CD-Rom Ed./Dist. : ANIMAGE Tél. : 05 46 55 00 57
Objectif
et contenu :
Permettre à un public d'adultes et de jeunes en difficulté de se réapproprier
les notions de base en mathématiques. Les produits de la collection ASSIMO sont
destinés à un public assez vaste principalement constitué d'adultes en
situation d'illettrisme. On peut estimer qu'ils sont regroupés dans trois
grandes catégories :
- les adultes souffrant de lacunes dans l'apprentissage des
savoirs de base pour lesquels retrouver une confiance en soi est un préalable à
une réinsertion durable,
- les jeunes en situation d'échec à la sortie du système
éducatif,
- les publics étrangers, en demande d'alphabétisation en
français.
Les
exercices proposés visent à travailler sur l'acquisition de la notion de
nombre, le sens des opérations élémentaires, et le raisonnement logique. Une
série de scénarios empruntés à la vie quotidienne amène à la résolution de
situations-problèmes. Les exercices proposés dans la collection Assimo sont
tous basés sur des mises en situations très proches de la vie quotidienne des
apprenants. Ces exercices suscitant leur intérêt, leur motivation rend
l'apprentissage plus aisé. (Ce produit, actuellement en développement sera
disponible courant 2003).
Mots
clés :
Mathématiques/Illettrisme/Apprentissage de base
ATELIER ESPACE
Logiciel -
5 Disquette(s), ou CD-Rom Ed./Dist. :
JONAS FORMATION Tél. : 05 59 56 59
11
Objectif
et contenu :
Développer et remobiliser des opérations intellectuelles permettant de
structurer l'espace, de se déplacer, de lire un plan, de comprendre les
relations spatiales entre les objets et leurs modes de représentation. Cet
outil est composé de huit modèles ayant chacun entre dix et trente exercices
organisés de façon progressive. Il s'inspire des travaux effectués par Piaget
et ses successeurs sur le développement opératoire de l'intelligence. A ce
titre, s'appuyant sur des outils de développement cognitif (ARL, PEI...), il
reprend les principes suivants : centration de l'apprenant, médiation du
formateur, analyse des raisonnements et des stratégies, verbalisation,
co-apprentissage... L'ergonomie privilégie très largement l'utilisation de
repères spatiaux, iconographiques, et le mode opératoire est en lui-même un
apprentissage au décodage de symboles graphiques utilisés dans l'activité de
résolution de problèmes spatiaux : emboîtement 2D (structurer la perception,
élaborer un système personnel de points de repère), puzzles 2D (structurer les
notions de symétrie, proportionnalité, rotations), laby 2D (structurer les
notions de points de vue, gauche, droite, devant, derrière), plans (structurer
les notions de repères orthonormés), métro (appliquer et différencier des
stratégies de déplacements), laby 3D (structurer les repères d'une perception
en trois dimensions, passer d'une vue en deux dimensions à une vue en
perspective), emboîtement 3D (développer les capacités à opérer
systématiquement des transformations de vues) et puzzles 3D (développer les
capacités à gérer en parallèle plusieurs systèmes de points de repère).
Mots clés :
Illettrisme
C.LOGIQUE
Logiciel -
1 CD-Rom Ed./Dist. : TNT Tél. : 03 20 67 11 38
Objectif et contenu : S'entraîner à la logique et se préparer aux épreuves de logique des concours administratifs. C.Logique est un outil d'entraînement à la logique. Il se décompose en 11 modules :
- suites numériques,
- suites alphabétiques,
- suites alphanumériques,
- suites numériques dans les figures,
- suites alphanumériques dans les figures,
- suites numériques fléchées,
- séries de mots,
- séries de mots en relation avec les chiffres,
- déplacements d'éléments dans les figures géométriques,
- symétries de figures,
- dominos,
Chaque
module est composé d'une série de 10 exercices et d'un complément d'une autre
série de 10 exercices. En fin de série, une correction est proposée : elle
présente la logique mise en oeuvre. Le principe adopté dans C.Logique, de
l'autocorrection avec une aide éventuelle, permet à chaque apprenant de
s'autoformer.
Mots
clés : Evaluation
des connaissances - Prix public
€ : 99.00 Euros.
ELEMENTAIRE MON CHER !
Logiciel -
1 Disquette Ed. : CRAPO Dist. : EDITIONS CHRYSIS - Tél. : 05 49 45
20 20 Objectif et contenu : Développer les habilités de résolution
logique et de calcul rapide chez les élèves. Le logiciel comporte 2 parties : Résolution
logique : L'élève doit placer des formes selon des indices dignes d'un
Sherlock Holmes. Le degré de difficulté augmente petit à petit et l'élève
résout des problèmes toujours plus complexes. Dans chacun des 77 niveaux de
difficulté, le logiciel choisit les formes du hasard. Jeu de serpents et
d'échelles surnommé, le tableau : pour avancer dans ce jeu, l'élève doit
répondre à des questions de mathématiques. Mots clés : Mathématiques
Prix public € : 18.29 Euros.
ENVOL MATHEMATIQUE
Logiciel -
1 CD-Rom Ed./Dist. : JERIKO Tél. : 01 49 29 41 61
Objectif
et contenu :
Comprendre les énoncés des situations-problèmes, pour mieux aborder leur
résolution. Pour résoudre des situations-problèmes, il faut comprendre leur
énoncé. Ce logiciel permet à l'enfant un travail de réflexion sur l'énoncé du
problème, sous forme d'aventure. Octavie a trouvé dans un vieux grimoire la
recette d'une potion magique qui permettrait de devenir un génie en maths. Mais
pour trouver les ingrédients de cette recette, le parcours est semé d'embûches
: il faudra résoudre 150 situations-problèmes, 4 énigmes et réussir l'ultime
épreuve. Le professeur Accem est la pour apporter son aide... Ce cédérom
propose donc différentes épreuves. LES SITUATIONS-PROBLEMES ET LEURS OBJECTIFS
: associer un énoncé à sa question (60), compléter un énoncé lacunaire (28),
comprendre un énoncé (30), écrire des données numériques (16). LES ENIGMES : un
anagramme, un carré magique, une dictée musicale et une classification animale.
L'ULTIME EPREUVE : maîtriser la compréhension en associant à un énoncé, son
titre, sa question, son schéma, et sa solution numérique. LE BILAN : l'enfant
pourra visualiser les épreuves réussies, celles qu'il n'a pas encore
effectuées, ainsi que le nombre de ses tentatives pour réussir chaque épreuve.
Il obtiendra en fin de parcours des diplômes et peut-être un verre de potion
magique!... Envol mathématique propose EN PLUS 72 énoncés à résoudre
mathématiquement.
Mots
clés :
Mathématiques Prix public € :
30.34 Euros.
IDEES EN ACTION
Vidéo - 1
cassette VHS Ed./Dist. : IMAGES POUR LA FORMATION Tél. : 01 45 55 89 00
Objectif
et contenu :
Analyser ce qui bloque la pensée créative, proposer quelques façons simples de
la libérer.. Ce composite aborde principalement les points suivants : les
différences entre les attitudes Dinosaure et Dauphin, les raisons du confinage
de notre pensée dans des limites que nous nous imposons et comment en sortir,
la façon d'améliorer notre capacité à résoudre des problèmes en remettant en
cause nos a priori, la manière d'éviter d'être un tueur d'idées, d'évaluer ses
idées de façon positive et créative et de prendre l'initiative pour passer des
idées à l'action.
Mots
clés : Technique de
développement personnel Prix public
€ : 800.00 Euros.
ID-PANNE
Logiciel -
9 Disquette(s) 3,5/CD-Rom Ed./Dist. :
TNT Tél. : 03 20 67 11 38
Objectif
et contenu : Se
familiariser avec une méthode de raisonnement systématique visant la résolution
de problèmes concernant des pannes sur des objets techniques de nature
différente. Le logiciel se présente sous la forme de 6 modules d'apprentissage.
Les trois premiers modules sont consacrés aux pré-requis notionnels nécessaires
à la compréhension de la méthode présentée : matière-énergie, systèmes et
sous-systèmes, notion de défaut. Le quatrième module présente une méthode
(étapes chronologiques présentées sous la forme d'un arbre). Le cinquième
module est une Simulation visant un
premier niveau d'appropriation de la méthode. Le dernier module est un
questionnaire à choix multiples, Panne en question, permettant de tester ses
connaissances en matière de situation de panne. Un module d'application,
Missions de dépannage, concernant six objets techniques dont les pannes
présentent des difficultés croissantes (cafetière, moniteur, lave-linge,
centrale d'alarme, imprimante matricielle, tour numérique), achève le
programme.
Mots
clés :
Electrotechnique Prix public € :
151.00 Euros.
LE CHOIX DE COLETTE
Logiciel -
1 CD-Rom Ed./Dist. : SAVOIRS
INTERACTIFS Tél. : 01 42 74 56 76
Objectif
et contenu :
Développer chez les personnels d'entreprises en re-qualification la capacité à
résoudre les problèmes d'autonomie et d'adaptation par rapport à un changement
de situation professionnelle. L'entreprise de Mme Mallet restructure son
service : deux nouveaux postes lui sont proposés. Prises de rendez-vous,
entretiens, critères de choix professionnels et personnels, besoins de
formation sont les clés de la prise de décision. Outils associés : outil du
formateur, banque d'exercices, accès à un bilan et à un historique pour un
suivi individuel ou une exploitation de groupe.
Mots
clés : Raisonnement
et logique
LES A.R.L. - ATELIERS DE RAISONNEMENT
LOGIQUE
Logiciel -
1 Disquette Ed./Dist. : CDE4 Tél. : 01 39 56 17 56
Objectif
et contenu :
Favoriser le raisonnement logique. Issue de la célèbre méthode classique des
Ateliers de Raisonnement logique, cette version logiciel permet aux apprenants
de niveau 6 et 5 bis de structurer les opérations intellectuelles de base du
raisonnement logique, de développer ses capacités personnelles, de favoriser la
sollicitation des compétences acquises et leur transfert à d'autres situations
lors de séances de socialisation. Les ARL sont constitués de 16 modules
comprenant environ 150 exercices de tous niveaux. Mots clés :
Raisonnement et logique
LES A.R.L. informatisés
Logiciel -
4 Disquettes Ed./Dist. : JONAS
FORMATION Tél. : 05 59 56 59 11
Objectif
: Faciliter la
structuration des opérations intellectuelles de base du raisonnement logique, à
travers un apprentissage individualisé et progressif, et développer l'autonomie
des apprenants. En référence à la théorie de J.Piaget, les ARL informatisés
proposent plus de 150 exercices de raisonnement permettant une mobilisation des
opérations intellectuelles logico-mathématiques. L'apprentissage proposé, d'une
durée moyenne de 50 heures, s'appuie sur une démarche pédagogique originale
(progression, interactivité, recours à différents modes de représentation).
Cette démarche est adaptée au public en difficulté sur le plan cognitif. Contenu
du logiciel : Apprentissage du mode opératoire. Exercices de niveau concret
Classification (17 exercices) - Combinatoire (9 exercices) - Inclusion (14
exercices) - Proportionnalité qualitative (15 exercices) - Transitivité (12
exercices) - Et/Ou (5 exercices) - Double transitivité (5 exercices) -
Transitivité généralisée (7 exercices). Exercices de niveau formel Implication
1(9 exercices) - Combinatoire (16 exercices) - Proportionnalité (18 exercices)
- Implication 2 (9 exercices) - Equivalence (3 exercices) Proportionnalité 2
(23 exercices) - Synthèse (5 exercices)
Mots
clés : Raisonnement
et logique
REPERES
Logiciel -
1 CD-Rom Ed./Dist. : LOGICOM
DIFFUSION Tél. : 02 51 79 00 85
Objectif
et contenu :
Evaluer la connaissance du vocabulaire dit de base, et participer à son
développement. Repères est destiné à l'évaluation et à l'apprentissage
d'environ 80 concepts de base. Ces derniers sont présentés en 6 séries
progressives. Les concepts concernent, de façon générale, les relations
topologiques (espaces et temps), les prépositions et adverbes qui régissent les
relations, ainsi que des notions davantage liées à une définition perceptive de
l'environnement, des objets. Module 1 : L'apprenant explore librement l'image.
Quand il clique sur un élément pertinent de l'image, le concept est prononcé
et/ou écrit. Module 2 : L'apprenant doit désigner sur demande tel ou tel
élément de l'image correspondant au concept de base. En cas d'erreur, un cadre
clignotant vert, entoure la bonne réponse. Module 3 : L'élève doit remettre en
place la définition écrite du concept (étiquette) sur l'image. Les principaux
concepts abordés dans Repères sont : gros, petit, grand, rond, bas, haut /
clair, ouvert / le plus haut, le plus loin, plusieurs, les mêmes, différent,
pareil, autant, jamais, contre, dans l'ordre, horizontal...etc
Mots
clés : Raisonnement
et logique/Evaluation des connaissances/Illettrisme - Prix public € : 257.00
SACREES MACHINES
Logiciel -
1 CD-Rom ou Internet/Intranet Ed./Dist.
: TNT Tél. : 03 20 67 11 38
Objectif
et contenu :
Assimiler les principes de base qui permettent de mieux manipuler les machines
et de mieux comprendre leur langage. Ce didacticiel se présente sous forme d'un
jeu de réflexion où l'apprenant doit : choisir une machine, découvrir la
mission qui lui est confiée et la mener à bien en un temps déterminé. Les tâches
suivantes sont proposées : découverte, déchiffrage, manipulation d'objets,
dialogue avec la machine et programmation.
Mots
clés : Culture
technologique de base/Apprentissage de base - Prix public € : 112.00
SORA, OU COMMENT BIEN REFLECHIR AVANT D'AGIR
Vidéo - 1
cassette vidéo U-Matic 3/4 Ed./Dist. :
FORMABOIS - Tél. : 01 40 19 49 83
Objectif
et contenu :
Comment bien réfléchir avant d'agir. L'extrême complexité de l'univers du
travail impose à chaque acteur de l'entreprise, de résoudre efficacement tous
les problèmes qui surviennent dans l'accomplissement de sa mission. Ce film a
été conçu pour permettre, lors de séminaires de formation, la résolution de
problème, d'illustrer par des exemples simples et distrayants : les difficultés
que l'on peut rencontrer lors des résolutions de problèmes mal conduites, les
quatre phases de la structure de résolution de problèmes. SORA : situer,
observer, réfléchir, agir.
Mots
clés : Raisonnement
et logique
SYLVADYS
Aide à la formation. Outil de recyclage
Logiciel -
1 Disquette Ed./Dist. : PROCESS
IMAGE Tél. : 04 42 39 77 23
Objectif
et contenu : Cet
EAO permet de former ou de recycler toute personne à la méthode de l'arbre des
causes, à la démarche d'analyse de dysfonctionnements ou d'accidents dans
l'entreprise. A l'issue de l'apprentissage les utilisateurs sont capables
:d'effectuer un recueil des faits, de construire un arbre, de lire et
interpréter un arbre, de déterminer les mesures préventives, de détecter les
facteurs potentiels d'accident ou de défaut.
Déroulement
: Huit modules
alternant cours et exercices permettent d'atteindre ces objectifs,
sollicitation permanente de l'apprenant, simulation, possibilités de créer des
exercices.
Mots
clés :
Sécurité/Sécurité du travail/Raisonnement et logique - Prix public € : 419.80
3) RESSOURCES : Technique de
développement personnel
ENTRAINEZ VOTRE MEMOIRE
Type : Logiciel Objectif : Consolider ses capacités à mémoriser. Contenu : Le CD-Rom - Mémoire -
s'adresse à tous ceux qui souhaitent renforcer et améliorer leur vivacité
d'esprit et leurs facultés intellectuelles. Il a été conçu et élaboré par
l'équipe de médecins, de chercheurs en Psychologie Cognitive et de spécialistes
en Sciences de l'Education d'HappyneuronTM. L'attention :
L'attention est indispensable à l'exécution de toute tâche. Elle est intimement
liée aux capacités de mémorisation et de compréhension. La mémoire :
Fonction cognitive la plus largement sollicitée, la mémoire contribue à la
constitution de l'identité de chaque individu en lui permettant d'acquérir des
souvenirs personnels, des connaissances culturelles et des aptitudes
particulières. Car, contrairement à ce que l'on pense, il n'existe pas une
seule mémoire...
Le
langage : oral, ou écrit, le langage est une activité mentale fondée sur
différentes analyses : construction grammaticale, signification des mots... Il
fait également appel aux connaissances personnelles de chacun, chaque individu
disposant de son propre stock de mots. La maîtrise de l'espace et l'imagerie
mentale : Identifier un objet, agir au sein de l'environnement, percevoir
une chose sans que cette chose soit présente et la déplacer mentalement :
autant d'activités irréalisables sans de bonnes capacités d'analyse visuelle et
d'imagerie mentale.
Les
fonctions exécutives : Pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne,
il est certes nécessaire de les comprendre, mais aussi de savoir analyser les
différents éléments, d'élaborer un raisonnement et d'établir un plan d'action,
en fonction du but à atteindre. Cela sera possible grâce aux fonctions
exécutives de logique, de stratégie, de planification et de raisonnement. Six
exercices interactifs originaux vous permettront de développer vos aptitudes
cérébrales de manière ludique. Vous pourrez également contrôler vos points
forts et vos points faibles en visualisant vos résultats personnels pour chaque
exercice.
Support : CD-Rom - Niveau : Tous niveaux - Mots
clés : Technique de développement personnel Distribué par : PASTEUR MEDIAVITA 28, rue du Dr Roux 75015
PARIS - Tél : 01 53 86 81 30 - Fax
01 53 86 81 54 - Les CD-Rom Pasteur Médiavita vendus exclusivement en
pharmacie.
4)
ressources : Vie quotidienne et histoire de vie
DESIR D'APPRENDRE
Type : Vidéo Objectif
: Présenter la lutte contre l'illettrisme par l'intermédiaire d'une association.
Contenu : A travers une mosaïque de
paroles, le LEFOP se raconte. Cette association de bénévoles relate sa pratique
quotidienne, ses difficultés, ses réflexions.... Une expérience originale de 10
années de lutte contre l'illettrisme dans un quartier de l'Abbaye-Jouhaux à
Grenoble. Ce film décrit l'engagement particulier de bénévoles et le désir
d'apprendre de personnes confrontées à l'illettrisme. Désir d'apprendre nous
présente une dynamique autour d'apprentissages tels que la lecture et l'écriture,
menée de façon personnalisée et, au-delà, autour de l'intérêt à créer des liens
dans le quartier.
Support : VHS -
Mots clés : Vie quotidienne/Insertion socioprofessionnelle/Illettrisme - Durée : 28 mn - Prix version unitaire :
Adhésion.Location Distribué par : VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS -
73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802 850 850 - Fax : 01 43 79 68 13
DROIT DE CITE
Type : Vidéo Objectif
: Montrer un exemple de réhabilitation d'habitat social générateur d'emplois
nouveaux et d'insertion socioprofessionnelle. Contenu : Au départ de ce chantier original de réhabilitation de la
Cité des Chaumes à Montauban, un projet associant notamment l'OPDHLM, les
entreprises, la Ville, la DDTEFP, le Conseil général. Cette opération de
réhabilitation, rendue nécessaire par l'état de vétusté de la cité, a eu pour
premier objectif l'amélioration du cadre de vie et des conditions nécessaires
de sécurité. La Charte Régionale pour l'Insertion, signée le 23 novembre 1993,
a facilité l'intégration de jeunes de cette cité au sein des entreprises
intervenant sur le site. Il ne s'agit pas de créer des emplois de
circonstances, mais de former de véritables professionnels. A la suite d'un
appel d'offre comportant la clause de mieux-disant social, dix jeunes de la cité,
sans emploi et sans qualification, sont embauchés au sein des quatre corps de
métiers intervenant sur le chantier : thermiste, isolateur par l'extérieur,
gros-oeuvre et menuiserie (au total 40 salariés). L'originalité de ce chantier,
explique le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, passe non seulement par l'amélioration apportée au bâtiment
mais aussi par la prise en compte des difficultés rencontrées par les habitants
de la cité et notamment les jeunes de moins de vingt six ans. Autre partenaire
essentiel : l'association Montauban service qui assure à la demande du Conseil
général un travail de proximité au sein de la cité : expliquer le chantier aux
habitants, les informer de sa finalité, de sa progression, de ses modalités,
d'une part ; suivre quotidiennement et assurer l'accompagnement social de ces
jeunes, d'autre part.
Support : VHS - Mots
clés : Vie quotidienne/Emploi/Insertion socioprofessionnelle - Durée : 20 mn - Prix version unitaire : Adhésion/Location Distribué par : VIDEOTHEQUE MODES
D'EMPLOIS 73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802 850 850 - Fax : 01 43 79 68 13
ET VOILA LE TRAVAIL
Type : Vidéo Objectif
: Présenter différentes solutions entreprises afin de lutter contre le chômage.
Contenu : Partout en France, des hommes et des femmes,
seuls ou en groupe, en entreprise ou en association, réagissent contre la crise
et le chômage et trouvent des solutions inventives et efficaces. Création
d'activités et d'emplois, solidarité au quotidien ou services de proximité...
Près de 70 initiatives sont présentées, en 1 mn 30 chacune, et sont
susceptibles d'inspirer des démarches comparables. Cette série d'émissions,
diffusée sur France 2 dans le cadre du programme, Et voilà le travail,
s'inscrivait dans la campagne nationale
d'information du gouvernement sur les nouvelles mesures en faveur de l'emploi.
Quelques exemples - Franchir
(Un centre de formation pour devenir gardiens d'immeuble polyvalents), Hôpital
Saint - Camille (Divers services ménagers destinés au personnel de l'hôpital),
Humus et vie (une entreprise d'insertion et de formation au recyclage des
déchets verts), ADM (Une aide à domicile pour personnes âgées et handicapées),
Cigale (des particuliers financent des créations d'entreprises), PRIE ( Un
programme de développement touristique en milieu rural pour la réhabilitation
de logements), Tous Travaux Espaces Verts ( Une entreprise d'insertion
spécialisée dans l'entretien de jardins et des espaces verts des
collectivités), etc...
Support : VHS - Mots
clés : Vie quotidienne/Emploi/Insertion socioprofessionnelle - Durée : 2 heures - Prix
version unitaire : 18.29 Distribué par : VIDEOTHEQUE MODES
D'EMPLOIS - 73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802 850 850 – Fax :
01 43 79 68 13
HELP
Type : Vidéo Objectif
: Sensibiliser aux problèmes liés à l'illettrisme. Contenu : A partir de témoignages de personnes en situation
d'illettrisme, des professionnels de la lutte contre l'illettrisme dans la
région de Basse-Normandie nous parlent de leurs démarches. Prévention dans une
crèche - utilisation d'une BCD (bibliothèque centre documentaire) en ZEP (zone
d'éducation prioritaire), où l'apprentissage de la lecture et de l'écriture est
encore plus difficile qu'ailleurs. Suivi et accompagnement - Formation des
jeunes et des adultes - accueil dans une ANPE - Mieux informer les assurés
sociaux.
Support : VHS - Niveau
: Tous niveaux - Mots clés :
Illettrisme/Insertion socioprofessionnelle/Vie quotidienne - Durée : 36 mn - Prix version unitaire : Adhésion/Location Distribué par : EDUCAGRI 26,
boulevard du Docteur Petitjean - BP 87999 21079 DIJON CEDEX T. 03 80 77 26 32 - F. 03 80 77 26 34
L'ENTREPRISE, LIEU D'ACCUEIL POUR LES JEUNES
Type : Vidéo Objectif
: Présenter l'entreprise, lieu d'accueil pour les jeunes. Contenu : De nombreuses interviews de stagiaires, de tuteurs
professionnels et de formateurs illustrent la réalité de l'accueil des jeunes
en entreprise. A travers ces témoignages, nous découvrons les bonnes et les
mauvaises pratiques de cette nouvelle approche de la formation : le stage en
entreprise. Par son authenticité, ce film s'adresse à tous les acteurs
concernés par la formation en alternance et peut intéresser les enseignants de
la formation initiale. Il permet de trouver les réponses précises pour une
meilleure approche des formations en entreprise.
Support : VHS - Mots
clés : Vie quotidienne/Insertion socioprofessionnelle/Alternance - Durée : 20 mn Editeur : EDUCAGRI - Prix
version unitaire : 18.19 Euros Distribué par : VIDEOTHEQUE
MODES D'EMPLOIS - 73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802 850 850 -
Fax : 01 43 79 68 13
LA MISSION LOCALE
Type : Vidéo/Logiciel Objectif : Présenter les missions locales, et les actions
d'accueil, d'orientation et d'information qu'elles sont appelées à jouer. Contenu : A travers des actions
d'accueil, d'orientation et d'information, plus de 600 missions locales
proposent aux jeunes de 16 à 25 ans une relation personnalisée et globale, les
guident dans l'élaboration de leur itinéraire et les accompagnent au cours de
leur parcours d'insertion. Elles apportent des réponses adaptées à l'ensemble
des difficultés qu'ils rencontrent avec une priorité à l'emploi, mais également
dans les domaines de la formation, de la santé, du logement, de la culture, du
sport, des loisirs et de la
citoyenneté. Le ministère de l'emploi et de la solidarité a donné la parole aux
jeunes de la mission locale de Torcy - Marne la Vallée qui ont été impliqués
dans tout le processus de conception et de réalisation de ce film. Ils
présentent ce qu'est une mission locale et pourquoi ils ont eu recours à cette
structure d'accueil. Récompensé lors du Festival Communica de Deauville 1999
par le Grand Prix Spécial de la Fondation de France, cette vidéo nous permet de
suivre les itinéraires de Karim, agent d'ambiance à la RATP, Laetitia, adjointe
bibliothécaire, Stéphane, Mohamed et Nassim agents de piste à l'aéroport
Charles de Gaulle.
Support : CD-Rom/VHS - Niveau : IV - Mots clés
: Vie quotidienne/Emploi/Insertion socioprofessionnelle Durée : 9 mn Prix version
unitaire : 18.29 Euros
Distribué par :
VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS - 73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802
850 850 - Fax : 01 43 79 68 13
LA QUADRATURE DU CERCLE
Type : Vidéo Objectif
: Présenter le cercle de recherche d'emploi en images. Contenu : La quadrature du cercle, en mathématiques, c'est la
construction géométrique d'un carré de même surface qu'un cercle donné. Le type
même du problème insoluble . Pourtant l'ANPE, au travers des cercles de
recherche d'emploi, peut apporter une aide aux demandeurs d'emploi. Ce film
raconte l'histoire d'une vingtaine d'hommes et de femmes qui ont suivi ce type
de stage. Il permet de se rendre compte du travail effectué pendant les 5
semaines que dure un cercle de recherche d'emploi.
Support : VHS - Mots
clés : Vie quotidienne/Emploi/Technique de recherche d'emploi - Durée : 52 mn - Prix version unitaire : Adhésion/Location Distribué par
: VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS - 73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802
850 850 – Fax : 01 43 79 68 13
LA VIE EN PLUS : ASSOCIATIONS ET NOUVEAUX EMPLOIS
Type : Vidéo Objectif
: Montrer qu'il est possible de professionnaliser de nouvelles activités à
travers l'exemple proposé par les associations. Contenu : Avec le programme Nouveaux Services, Nouveaux Emplois
pour les jeunes, la capacité des associations à professionnaliser des activités
émergeantes, est au cœur de l'actualité. Ce ne sont pas seulement des nouveaux
métiers qu'il convient d'identifier, mais des activités de service grâce
auxquelles usagers, bénévoles, prestataires, etc. trouveront leur compte.
L'émission, à partir de la mobilisation engagée dans le Nord-Pas-de-Calais,
explique la dynamique proposée par ce programme. Elle montre en quoi celui-ci
n'est pas un dispositif de plus à l'usage de chasseurs de primes mais un moyen
de mettre en évidence, à partir de réalités concrètes d'une région, des
activités nouvelles susceptibles de se professionnaliser.
Support : VHS - Mots
clés : Vie quotidienne/Emploi - Durée
: 26 mn - Prix version unitaire :
Adhésion/Location Distribué par :
VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS 73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0802 850
850 – Fax : 01 43 79 68 13
LA VIE EN PLUS : TRAVAIL ET HANDICAP
Type : Vidéo Objectif
: Informer sur les mesures prises en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées. Contenu
: Une émission réalisée à l'occasion du 10ème anniversaire de la loi sur
l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Plus de 60% des entreprises
font appel à des personnes handicapées ; pour les autres, une alternative :
verser une contribution à l'AGEFIPH, le fonds pour l'insertion professionnelle
des personnes handicapées. A partir de témoignages d'une grande sensibilité, ce
programme offre un regard différent sur l'insertion des personnes handicapées.
Support : VHS - Mots
clés : Vie quotidienne/Emploi/Insertion socioprofessionnelle/Handicapés - Durée : 26 mn - Prix version unitaire :
Adhésion/Location Distribué par : VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS 73
rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802 850 850 – Fax : 01 43 79 68 13
LE PARRAINAGE POUR L'EMPLOI DES JEUNES
Type : Vidéo/Logiciel Objectif : Faciliter l'accès à l'emploi des jeunes par le
parrainage. Contenu : Initié depuis
deux ans à titre expérimental, le parrainage a pour objectif de faciliter l'accès
à l'emploi des jeunes sans qualification et de les stabiliser dans leur
travail. Un parrain, bénévole, actif ou retraité, désigné par une Mission
locale ou une PAIO, accompagne le jeune dans sa démarche de recherche d'emploi
et l'aide à s'adapter au monde de l'entreprise. Au travers des portraits de 5
jeunes et de leurs parrains, on découvre l'efficacité du dispositif de
parrainage comme moyen d'accroître efficacement les politiques d'insertion
professionnelle des jeunes.
Support : CD-Rom/VHS - Mots clés : Vie quotidienne/Emploi/Insertion socioprofessionnelle -
Durée : 15 mn Prix version unitaire : Adhésion/Location Distribué par
: VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS 73 rue de Volga 75020 PARIS - Tél : 0 802
850 850 - Fax : 01 43 79 68 13
LES GEIQ
Type : Vidéo/Logiciel Objectif : Présenter ce que sont les GEIQ : groupements
d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Contenu : Le GEIQ est un groupement d'employeurs. Sa mission est
d'organiser des parcours d'insertion et de qualification au bénéfice des
publics en difficulté, jeunes gens sans qualification, chômeurs de longue
durée, bénéficiaires du RMI. Réalisé avec cinq GEIQ issus de deux régions, la
Picardie et Rhône-Alpes, ce petit film documentaire s'adresse d'abord aux chefs
de petites et moyennes entreprises qui sont confrontés à des difficultés liées
à la saisonnalité de leur activité et au recrutement de leur personnel. Plus
généralement, il est destiné à sensibiliser les acteurs de l'insertion sociale
et professionnelle aux spécificités de cette formule. L'implication des
entreprises constitue l'une des principales conditions de réussite du GEIQ.
Chefs d'entreprises, tuteurs, salariés et coordonnateurs livrent leur
expérience.
Support : CD-Rom/VHS - Mots clés : Vie quotidienne/Emploi/PME/Insertion
socioprofessionnelle - Durée : 20 mn
- Prix version unitaire : 18.29
Euros Distribué par : VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS - 73 rue de Volga
75020 PARIS - Tél : 0802 850 850 –
Fax : 01 43 79 68 13
LIRE ET AGIR
Type : Vidéo Objectif
: Adapter les salariés dits de faible niveau. Contenu : L'entreprise se transforme : mutations technologiques,
organisationnelles, économiques...Les modifications des postes de travail
engendrées par ces évolutions peuvent produire et révéler des difficultés
d'adaptation des salariés dits de faible niveau. Ce film accompagné d'une
mallette pédagogique comprenant un guide méthodologique et un outil de
diagnostic, a pour objectif d'aider à optimiser ses pratiques pour favoriser
l'adaptation des salariés les plus en difficulté. La faible qualification et
l'illettrisme sont des freins à l'adaptabilité aux changements et, en
conséquence, à l'employabilité des personnes concernées. Mais la formation peut
constituer un remède efficace. C'est la démarche retenue par ce produit pédagogique
original.
Support : VHS - Mots
clés : Vie quotidienne/Insertion socioprofessionnelle/Illettrisme - Durée : 40 mn - Prix version unitaire : Adhésion/Location Distribué par :
VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS 73 rue de Volga 75020 PARIS Tél :
0802 850 850 - Fax : 01 43
79 68 13
PAROLES D'HABITANTS, MANIERES D'HABITER
Type : Vidéo Contenu
: Chronique villageoise d'une année à Sérignac, 500 habitants, dans le
Tarn-et-Garonne. On traverse le village comme la vie. L'année est rythmée par
les temps ritualisés, la Toussaint, le 11 novembre, la fête votive, la fête des
battages, les manifestations associatives. L'espace du village est découpé par
les lieux de mémoire, de rencontre, d'intégration, de services, de loisirs. Les
habitants nous parlent de leur village, de leur commune, des manières
d'habiter, des sentiments d'appartenance, de comment on peut être rural
aujourd'hui, de l'identité communale face aux recompositions territoriales. Ce
film, issu des travaux du Laboratoire de Dynamiques rurales de l'ENFA, en
partenariat avec l'UTM et l'ENSAT, pose la question du sens de la petite
commune rurale aujourd'hui, dans le cadre des recompositions territoriales.
Support : VHS - Niveau
: Tous niveaux - Mots clés : Vie
quotidienne-Agriculture-Environnement - Durée
: 42 mn - Editeur : EDUCAGRI Prix version unitaire : 22.00
Euros Distribué par : EDUCAGRI 26, boulevard du Docteur Petitjean - BP
87999 21079 DIJON CEDEX - Tél : 03
80 77 26 32 - Fax : 03 80 77 26 34
PAROLES ET TEMOIGNAGES SUR L'Illettrisme
Type : Vidéo Objectif : Présenter le
parcours de personnes illettrées.
Contenu : Des illettrés vivant en milieu urbain
témoignent de leur isolement et de leurs difficultés dans un monde où l'écrit
est omniprésent. Ils expliquent comment ils ont réussi à suivre des cours
d'alphabétisation.
Support : VHS - Niveau
: Tous niveaux - Mots clés : Illettrisme/Français/Vie quotidienne - Durée
: 41 mn. Distribué par : CNASM Centre hospitalier - 5 avenue du Général
de Gaulle - 57790 LORQUIN Tél :
03 87 23 14 79 - Fax : 03 87 23 15
84
POINT DE VUE SUR L'INSERTION
Type : Vidéo Contenu
: Document sur le thème de l'insertion réalisé en atelier vidéo par des
personnes bénéficiaires du RMI à partir de rumeurs et passant par le point de
vue de l'administration, les membres de l'atelier portent un regard sur les
lieux d'insertion qu'ils ont découvert dans le Bassin houiller lorrain.
Support : VHS - Niveau
: Tous niveaux - Mots clés : Vie
quotidienne/Insertion socioprofessionnelle - Durée : 28 mn - Prix version
unitaire : 22.87 Euros
Distribué par :
OAVUP 95 avenue du Recteur Pineau 86022 POITIERS Tél : 05 49 45 32 26 -
Fax : 05 49 45 32 30
SAUVE-MOI - TRANCHES DE VIE A ROUBAIX
Type : Vidéo Objectif
: Contenu : Sorti en salles en
septembre 2000, ce film tient son scénario d'un atelier d'écriture organisé à
Roubaix et qui a réuni dix-sept privés d'emploi, dix-sept personnalités que
rien, à priori, ne disposait à l'écriture. De cet atelier, soutenu par le
Ministère de l'Emploi, est né un roman - Ne crie pas - et un film - Sauve-moi.
Si le film n'est pas la stricte adaptation du roman, il en est l'écho, comme il
est l'écho des récits et des situations entendus, racontés et vécus lors de
cette aventure. Mehdi tourne dans les rues de Roubaix, à bord de son taxi
clandestin. Il vit de petits boulots. Mehdi a quelques amis qui lui sont chers.
Il y a Sergio, Willy, Marc, Cécile, la famille, Mémé et tous les autres. Et
puis un jour Agatha débarque. Elle vient d'un pays où la mort a fait des
ravages, mais elle est pleine de vie. Elle est de passage, elle ne restera pas.
Il faut l'aider, lui trouver un toit, de l'argent. Agatha va bousculer Mehdi et
sa tribu, leur ouvrir d'autres horizons. Les sauver.
Support : VHS - Niveau
: Tous niveaux - Mots clés :
Emploi/Insertion socioprofessionnelle/Vie quotidienne Durée : 1 heure 40 mn - Prix
version unitaire : Adhésion/Location
Distribué par :
VIDEOTHEQUE MODES D'EMPLOIS - 73 rue de Volga 75020 PARIS Tel :
0802 850 850 - F. 01 43 79 68 13
Distribué par :
CNASM Centre hospitalier - 5 avenue du Général de Gaulle - 57790 Lorquin - Tél :
03 87 23 14 79 - Fax : 03
87 23 15 84
TRAVAILLER EN CAT
Type : Vidéo Objectif
: Montrer le soutien apporté par les CAT dans l'insertion professionnelle des
handicapés. Contenu : Le Centre
d'Aide par le Travail offre à des milliers d'adultes handicapés une possibilité
d'insertion sociale et professionnelle. Comment ces travailleurs vivent-ils
leur quotidien, à l'atelier, dans les transports, lors des repas ? Quand ils
peuvent, pour un temps, travailler en entreprise ordinaire, comment jugent-ils
leur situation? Enfin que deviennent ceux qui ayant été embauchés, ne dépendent
plus du CAT ?
- Durée : 20 mn - Prix version unitaire : 57.93 Euros Distribué par : CNASM Centre hospitalier - 5 avenue du
Général de Gaulle 57790 LORQUIN T. 03
87 23 14 79 - F. 03 87 23 15 84
2.B) Travail à
partir de la Boîte à Outils Multimédias
1)
Extrait de la partie introductive de la BOM
La production structure l'activité et l'activité structure
l'apprentissage.
L'usage
du multimédia peut participer à cette reconnaissance en plaçant l'apprenant
comme acteur de sa formation. Par nature, l'ordinateur est un outil de calcul,
au sens large, et donc de production où la gestion de l'erreur est possible. La
production (textes, tableaux, fichiers, plaquettes de présentation, études de
cas, dossiers personnels ou collectifs, simulations, enquêtes, images,
expositions, spectacles, chantiers-actions, etc...) sont autant de champs
d'expérimentation individuels ou collectifs offrant la possibilité d'un regard,
non pas sur la "boîte noire[6]"
de chaque individu, mais sur ce qui, dans son activité, est observable. Nous
faisons ici explicitement référence aux conceptions de la théorie de
l'information des années 50 qui a inspiré largement les courants de
l'éducabilité cognitive.
L'approche
cognitiviste a tendance à réduire la pensée à ses fonctions mécaniques de
perception, de sélection, d'organisation et de restitution. Aujourd'hui la
comparaison du fonctionnement de l'ordinateur et du fonctionnement du cerveau
humain, repris à la fois dans le cadre des Neurosciences et de l'Intelligence Artificielle (IA), se
heurte rapidement à l'impossibilité d'intégrer, dans ce type de modèle, les
caractéristiques proprement humaines qui sont celles de la recherche/construction
perpétuelle du sens par la personne.
C'est
à partir de l'observation de cette personne que l'on peut avoir le point
d'ancrage dans la relation. C'est alors au formateur, à partir de cette
observation systématique, de renvoyer graduellement "en Feed-back"
des éléments nouveaux (attitudes, conseils, outils, ressources, situations,
pairs, etc ..) et propres à chaque individu pour qu'il affine, par contrôles
approximatifs, successifs et mutuels son activité, et donc, structure son
apprentissage. C'est dans cette dynamique de relation d'aide en spirale que
débute la connaissance.
La régulation pédagogique par
rétro-action
|
|
Espace ressource outils,
organisations et pairs |
|
|
"Input" |
|
"Output" |
|
|
Apprenant |
|
|
|
Action du formateur dans la situation pédagogique |
|
Deux principes :
- repérer les
processus, les représentations, les blocages et les erreurs en observant les résultats sur les contenus
produits par l'apprenant,
- remédier
par des stratégies "personnalisées" en retour.
2) Rubrique «BILan» (BIL) :
http://www.mipplus.org/bom/menurub.htm
- fiche «Atelier Eval II» - Jonas & TNT
3) Rubrique «LanGage et logiquE»
(LGE) :
http://www.mipplus.org/bom/menurub.htm
- fiche «Atelier Espace» - TNT
- fiche «Atelier de résolution de problèmes – APP
Dijon»
(outil non commercialisé)
-
fiche «C.Logique – TNT»
-
fiche «Entraînez votre mémoire – Emme»
-
fiche «Tests de QI – MicroAPP»
-
fiche «Apprendre, comment ça marche ? – CSI»
voir plus bas
4) Rubrique «Culture Générale et
Scientifique» (CGS) :
http://www.mipplus.org/bom/menurub.htm
-
fiche «Les secrets de l’intelligence – Cédérom»
5) Rubrique «Culture Technique et Professionnelle» (CTP) :
http://www.mipplus.org/bom/menurub.htm
- fiche «Cube 4 – Chrysis»
- fiche «Sacrées Machines –
TNT»
- fiche «ID-Panne – TNT»
6) Rubrique «Outils du FormaTeurs» (OFT :
http://www.mipplus.org/bom/menurub.htm
- fiche «Gingo, les Arbres de connaissances
– Trivium»
- fiche
«GesTemps» - J Kaplan»
- fiche «TAM TAM» - Juste-a-Temps
7) Rubrique «Ressources et réseaux» (RES) :
http://www.mipplus.org/bom/menurub.htm
-
fiche «TFS, série TV mieux se connaître
– AFP»
8) Bibliographie : Apprentissage,
multimédia et TIC – MIP +
http://www.mipplus.org/biblio_app&tic
-
formation
et multimédia
-
sociologie
et multimédia
-
pédagogie
générale
-
pédagogie
des ressources multimédias
-
revues
et multimédia
-
ressources
documentaires, outils usages et multimédia
-
liste
de diffusion sur Internet : NTIC et leurs usages
-
bibliographie
accessible et actualisée sur Internet
9) Extrait de la
fiche BOM : Apprendre, comment ça marche ? - CSI
Site Internet :
«Apprendre, comment ça marche ? – CSI»
Extrait de la fiche BOM :
Approche ludique de type «brainstorming interactif et multimédia» / CSI
http://www.cite-sciences.fr/apprendre/francais/comment/index.htm
Le désir d’apprendre ou Apprendre, comment ça marche ?
Dans la vie, il n’y a pas que boire, manger, dormir !
Il y a aussi .. apprendre. C’est une activité que l’on pratique à tous âges en
maintes situations et de multiples manières. Mais apprendre, comment ça
marche ? Jouez maintenant à découvrir les multiples facettes de
cette captivante aventure !
1) Vais-je y arriver ? : Acquérir un tour de main
d’un spécialiste passe par l’observation et l’action. Quel que soit le
domaine, apprendre à sauter à la perche, à utiliser une perceuse ou faire des
crêpes, il s’agit à chaque fois de décomposer le mouvement et de le reproduire.
Puis, c’est en exerçant que l’on acquiert de l’aisance. Deux
clips Real Vidéos (en dérangement): «le tour de magie» et «ils ont
essayé».
Un processus personnel : Pour apprendre le tour de
magie, pour apprendre à utiliser un
outil, pour apprendre une série de gestes, chacun de nous a sa façon de faire.
Nous sommes encombrés de représentations qui nous freinent et nous cherchons
des repères, des indices, pour essayer de maîtriser le processus. Il s’agit
toujours, mais chacun à sa façon, de se situer par rapport à un environnement.
Nous arrivons à la compréhension de ce que nous devons apprendre par
approximation successive, par ajustements à ce qui nous entoure. Nous essayons
de nous souvenir ou de donner du sens. Ce sont des processus communs à tous et
pourtant spécifiques à chacun. Il s’agit toujours pour la personne qui apprend,
de se mettre en jeu dans une réalité commune.
Pour en savoir plus :
- Ouvrages : des connaissances de l’enfant à
l’adulte, Claude Bastien – Armand Collin , 1997 – L’oiseau jardinier,
Paul Caro – 1986 & Petite philosophie à l’usage des non-philosophes,
Albert Jacquard – Calman Lévy, 1997
- Revue : Sciences cognitives, Le courrier du CNRS,
N°79 – Octobre 1992.
- Article : Apprendre dans la société de l’information
on cognition, Paul Carro – L’illettrisme en sciences, André Giordan &
Enseigner n’est pas apprendre, André Giordan – L’enseignant LC N°61 – février
1996
2) Casser vous la tête : On apprend tous les jours. Les
occasions ne manquent pas et chacun gère ça à sa manière. D’ailleurs que
serait-on sans la richesse des expériences. Trois animations jeu avec Shockwave
sur la mémoire «Qui fait quoi ?», «Histoire de mots» et «La femme de
Jacques»
A chacun sa stratégie : apprendre est une aventure
personnelle, le fruit d’une action dynamique et volontaire. Tout au long de
notre vie, nous rencontrons des tas d’occasion d’apprendre dans des domaines
très divers. Le champs des connaissances possibles est très vaste. Alors,
apprendre comment ça marche ? Tous de la même manière et de façon unique
pour chacun ! Selon la personne, le chemin diffère. Tel individu s’aide de
petits dessins, tel autre organise les données en tableau. Chacun développe ses
propres moyens, mais il s’agit, toujours et pour tout le monde, de donner du
sens. Prendre conscience de la diversité des chemins possibles pour
l’apprentissage, c’est se forger un nouvel art d’apprendre… De quoi s’ouvrir de
nouveaux horizons !
Pour en savoir plus :
- Ouvrages : Traité de psychologie – IV Apprendre
et mémoire, Paul Fraise & Jean Piaget Antonio Damasio – PUF 1964 & Des
idées pour apprendre, André Giordan & Françoise Guichard – Z Editions -
1997
- Catalogue : La fabrique de la pensée – Catalogue
de l’exposition – CSI - 1990
- Revue : L’émergence de la pensée, Sciences Humaines,
N°87 – Octobre 1998, La pensée – Science & Avenir, hors série N°114 –
avril/mai1998, Comment apprenons-nous ? Euréka N°22 – septembre 1997
-
Article : The effect of context on cognition, Stephen Ceci & Antonio
Roazzu - 1994
3) Que d’émotions : Qu’elles nous stimulent ou nous
déstabilisent, nos émotions sont à la source de tout apprentissage. C’est
ce que vous allez découvrir ici à travers une animation et un
questionnaire : un clip Real Vidéos V8 Basic (en dérangement)
«L’auto-école» et une animation Shockwave sous forme d’un questionnaire
«Questions d’émotions»
Un
moteur à apprendre : les émotions perturbent-elles l’apprentissage. Peut-on les
dissocier de la raison. Faut-il les considérer comme des alliés ? Les recherches
actuelles en neurobiologie montrent que les activités nerveuses liées aux
émotions et celle impliqués dans la cognition sont indissociables. Ces travaux
rejoignent ceux des psychologues qui explorent et théorisent le rôle
fondamental des affects dans nos capacités à apprendre et à agir. Inquiétude,
colère, détresse, jubilation… nos émotions laissent en nous des traces que
chaque nouvelle expérience réactive. Apprendre à les reconnaître et à les
écouter, c’est offrir un véritable moteur aux apprentissages à venir…
Pour en savoir plus :
- Ouvrages : Descartes’ Error - Emotion,
reason and the humain brain, Antonio Damasio – 1994 & L’intelligence
émotionnelle, Daniel Goleman – Robert Laffond - 1997
- Revue : La mémoire, la recherche N° 267 – Juillet Août
1994
- Article : La perception et la reconnaissance des
expressions émotionnelles faciales, Anna Tcherkassog – Information sur les
Sciences Sociales - 1997
4) Agitez vos neurones : On dit que le cerveau se fige à
vingt ans, se détériore avec l’âge, ne sait pas de réparer. C’est complètement
faux. Vous allez découvrir pourquoi … Deux animations avec Shockwave sur «Corps
et cerveau» (quelques fautes de frappe dans les commentaires) & «Le cerveau
plastique».
Le cerveau caméléon : des milliards de synapses en
perpétuelle adaptation animent le cerveau, ce réseau complexe qui nous permet
de penser, d’agir, d’exister. Les neurosciences ont récemment montré qu’il se
caractérise par une grande plasticité, c’est-à-dire que son fonctionnement
s’adapte constamment et à tous âges à nos activités quotidiennes. Plus une tâche est nouvelle et complexe,
plus les structures cérébrales se mobilisent. Ainsi, chacun de nos
apprentissages, chacune de nos expériences modifie la structure et la
réactivité chimique de notre cerveau qui bouge. Nous le construisons sans
cesse ! De quoi se dire que rien n’est jamais perdu et qu’il n’est jamais
trop tard pour s’y mettre.
Pour en savoir plus :
- Ouvrages : Le cerveau, Ad Dudink & Ron Van
der Meer – Seuil, Le cerveau - un inconnu, Dictionnaire encyclopédique
d’Oxford, sous la direction de Richard L. Grégory – R Lafont 1987 & 1993 – L’enseignement
scientifique, comment faire pour que cela marche ? G de Vecchi & A
Giordan, Z Edition 1989
- Revue : Le cerveau en mouvement, Sciences et vie hors
série N° 204 septembre 1998 & Voir le cerveau, La Recherche N° 289 juillet
Août 1996
- Article : Voyage au cœur du cerveau – Enquête d’Eric
Fottorino – Le Monde 1998.
5) Histoire de fous : on apprend à partir de ce qu’on est
et en s’appuyant sur ce que l’on connaît déjà, c’est sûr... mais on apprend
surtout en bousculant nos conceptions. Alors, êtes vous prêt à bouger les
vôtres ? Huit animations avec Shockwave : «Histoire de 6», «L’ouragan», «La souris folle», «Neuf points
a relier», «Prisonnier de nos représentations», «Trouver la suite», «A la
ligne» et «L’effet Stroop».
(quelques fautes de frappe dans les
énoncés !)
Le doute est roi : L’apprentissage est le résultat de
transformations successives, de résistances, de ruptures. Ces micro-révolutions
provoquent un déséquilibre dans notre façon d’être, de penser, de faire . Alors
… assimiler de nouvelles connaissances se fait à ce prix. Certitudes et
convictions sont alors de sérieux ennemis qu’il nous faut traquer si on veut
apprendre. Le trouble momentané qui accompagne l’apprentissage et le doute
qu’il provoque, offrent les meilleurs atouts à celui qui veut s’ouvrir à un
nouveau savoir. Dans l’acquisition d’une connaissance, le doute est roi et vaut
mieux ne jamais l’oublier. C’est parfois extrêmement déstabilisant … Mais
n’est-ce pas ce qui rend l’aventure si captivante ?
Pour en savoir plus :
- Ouvrages : Conception et connaissance, A
Giordan & P Lang, 1994, L’homme cognitif, A Weil-Barais – PUF
1993
- Cédérom : Les secrets de l’intelligence, B Lévy & E
Servan Schreiber
- Revue : L’intelligence, Le Monde de l’Education N°
255 – Janvier 1998
- Article : Au fond de l’action, la conceptualisation –
G Vergnaud.
- Thèse : Des neurosciences aux sciences de
l’éducation, D Fabre 1997.
6) Un temps pour tout : apprendre le tango en 15 leçons et
le chinois en 2 semaines ! Qui n’a jamais été attiré par de telles
formules ? Qui n’a pas essuyé les échecs cuisants ? Hé oui !
pour apprendre, il faut mettre le temps de son côté. Mais regardez plutôt :
Deux animations avec Shockwave dont une avec sonorisation : «Tracer un
idéogramme» et «Bébé et babils».
La magie des expériences : Quel qu’en soit le domaine, on ne
devient pas expert en cinq minutes ! Hé, non Ce serait trop simple !
Pourtant, on cherche souvent à réduire le temps d’apprentissage. C’est
stupide ! Nous savons dès l’enfance qu’apprendre se fait dans le temps.
Devenir compétent requiert toujours efforts t patience. C’est dans la durée que
nous construisons notre savoir. Comme chacun de nous apprend à son rythme,
c’est à force de répétition et d’ajustement dans des contextes variés qu’on
s’initie. C’est en multipliant les expériences dans des situations tour à tour
familières et inattendues que nous assimilons en profondeur de nouvelles connaissances.
Pour en savoir plus :
- Ouvrages : Les découvreurs, D Boorstin –
Robert Laffont – Comment la parole vient aux enfants ? B de Boysson
– Bardies – Pour ne plus vivre sur la planète Taire, J Salomé – A Michel
– 1991 – Mère-enfant, les premières relations, D Stern – P Mardaga 1977
- Revue : Eduquer et former, Sciences Sociales Hors
série N°12 – Février/Mars 1996
- Article : Mémoire et
psychologie légale : contexte et transfert inconscient dans
l’identification des visages, N Rainis & g Tiberghien – Psychologie
française N°40 3 – 1995 & Filles-garçons, ML Verdoer Gibello – L’Ere N°11,
octobre 1993.
III) Premiers résultats de cet état des lieux
3.1) Apprendre à apprendre :
une approche neuve et plurielle
La
problématique de «l’apprendre à apprendre» traverse plusieurs territoires avec
un ancrage variable. C’est le premier résultat de notre investigation. Sans
vouloir chercher l’exhaustivité, nous nous sommes attachés, dans un premier
temps, à repérer les secteurs d’activité dans lesquels la notion d’apprendre à
apprendre était citée, mentionnée, débattue, analysée, et aussi, mise en œuvre.
La
notion «d’apprendre à apprendre» étant elle-même, relativement neuve dans le
champ de la formation, apparaît comme polysémantique, dépendant largement
des territoires sur lesquels elle prend
forme :
-
pour la formation initiale, «apprendre à apprendre» n’apparaît aujourd’hui qu’à
la marge, et plutôt sous la forme «apprendre autrement», ou plutôt voire
«enseigner différemment», même si la pédagogie de Freinet ou les travaux
de Piaget ont largement étaient inspirés par ce secteur d’activité. Le modèle
transmissif des connaissances est encore largement dominant. Dans ce contexte,
l’élève-apprenant» a un champ d’initiatives relativement restreint au profit de
la gestion de l’activité du groupe «classe» pour l’école, le collège et le
lycée, au profit de «la promotion» pour l’enseignement supérieur ou au profit
du «stage» pour la formation des adultes. Dans tous ces cas, le concept
«apprendre à apprendre» n’existe pas en tant que tel. Il s’agirait de modifier
la posture du maître plutôt que celle de l’élève.
-
pour l’université, le concept apprendre à apprendre semble apparaître au
travers des travaux et des méthodes liées à l’éducabilité cognitive ou
liées au travail coopératif.
-
pour la formation des adultes, le concept d’ «apprendre à apprendre» est
couplé aux réflexions et aux pratiques, soit du développement de
l’individualisation de la formation, soit celui de l’autoformation. Il s’agit
de partager avec l’apprenant une réflexion et une action, d’ordre personnel et
méthodologique, pour l’aider dans ses stratégies d’appropriation des
connaissances. C’est dans la logique de l’accompagnement de l’apprenant
vers une nouvelle posture de co-construction du savoir que les pratiques
d’apprendre à apprendre prennent corps, en particulier dans le champ des FOAD,
où l’introduction des NTIC joue un rôle de révélateur dans la mise en place de
l’individualisation distance. Comment apprend t-on à distance, comment apprendre
à apprendre en FOAD ?
Si
la question de l’apprendre à apprendre est souvent mentionnée, celle de
«l’apprendre à s’auto-former» est plus rare.
3.2) Premières définitions de «apprendre à apprendre»
Définitions
extraites de la recherche documentaire :
Définition
1 : L’éducabilité cognitive est l’ensemble des pratiques, des techniques qui ont
pour objet explicite et principal de développer l’efficience et
l’autonomisation des apprentissages et réactivant de façon systématique les
procédures de pensée, les structures mentales dont la personne dispose et
dont elle prend conscience. D’après apprendre peut-il s’apprendre ?
Les Cahiers Pédagogiques N°280
Définition 2 : La formation sur mesure ou «Apprendre à apprendre»
: s’outiller pour faciliter l’apprentissage, c’est-à-dire connaître ses forces et ses faiblesses et, partant,
celles des autres, identifier ses forces et ses faiblesses en période
d’apprentissage; définir les besoins qui en découlent; anticiper les moyens
d’action pour apprendre ; prendre en mains son propre développement et
rechercher les occasions d’apprentissage et profiter de toutes les occasions
possibles pour compléter et enrichir son apprentissage.
Exemple du service formation de
l’Université de Montréal.
Définition
3 : Apprendre
à apprendre par
l'expérience, c'est apprendre au contact de son environnement dans
une relation directe et authentique. A chaque fois que l'homme interagit
avec son environnement dans une recherche d'ajustement à ses besoins, il
expérimente des solutions nouvelles qui enrichissent son vécu expérienciel et
lui permettent de retrouver la satisfaction de ses besoins. Dans ce processus
d'apprentissage, l'individu est acteur et en échange constant avec son
environnement. Il est dans l'action et dans la réflexion. Plus ce contact est
intense, plus la progression est importante. Apprendre à apprendre par
l'expérience signifie que chaque individu développe sa capacité à apprendre par
lui-même de ses expériences, de manière à ce qu'il soit capable de transformer
ses situations de vie en situations apprenantes. C'est un acte dynamique,
vivant, qui lui permet d'apprendre sans discontinuer.
Source FMK Consulting
Définition
4 : Pour résumer les objectifs pédagogiques de
l’apprentissage coopératif, «on peut dire qu’il faut coopérer pour apprendre
et apprendre à coopérer, ce qui suppose aussi de développer des compétences
transversales utiles pour la vie dans le monde du travail et dans la société.
Un objectif et un résultat attendu, plus ambitieux de l’apprentissage
coopératif est de rendre les apprenants capables d’un comportement réflexif. Il
se traduit par une capacité à
s’interroger, au travers du processus coopératif et de la confrontation avec
d’autres pratiques et à modifier son propre processus d’apprentissage, avec l’aide d’un agent éducatif (tuteur).
C’est-à-dire atteindre le vieux principe d’apprendre à apprendre
Source : Alain Derycke – extrait d’un
article publié dans l’AFP N° 179 juillet août 2002
«L’apprentissage coopératif en ligne, l’apport de la
recherche».
3.3) «Apprendre à apprendre» vu par les membres de l’action
Equal
Claudine Burguet
Se
confronter à nouveau à l’apprentissage, quand des expériences précédentes ont
été douloureuses, frustrantes ou simplement infructueuses est une étape très
difficile, car il faut être en capacité de porter un regard différent sur
l’apprentissage. Or pour porter ce regard différent, il faut pouvoir aborder le
changement de manière positive, afin de favoriser la possibilité pour le sujet de trouver en lui-même les ressources
dont il aura besoin pour réussir cette expérience. Pour cela de nombreuses
conditions doivent être réunies :
-
Avoir une idée d’un projet de vie, personnel, professionnel…et identifier
l’utilité d’apprendre telle ou telle chose pour la mise en œuvre de ce projet.
-
Acquérir la capacité d’apprendre à penser, c’est à dire de modifier sa relation
à l’environnement et aux autres mais aussi de modifier l’image que la personne
a d’elle-même.
-
Mais aussi, être curieux, se poser des questions, avoir envie de chercher des
réponses. Mais aussi, être suffisamment autonome, organisé, pour avoir la
capacité d’aller chercher les réponses ou au moins des éléments de réponses.
Etre convaincu que l’on a des
capacités, que l’on sait, que l’on peut réaliser, que l’on peut apprendre des
choses qui paraissaient impossibles précédemment.
-
Avoir à disposition des outils appropriés qui à la fois, sont attrayants,
accessibles et efficaces dans la transmission des contenus.
Apprendre à Apprendre doit, pour moi, traiter l’ensemble de cette
problématique, c’est-à-dire mettre à disposition des postulants à
l’apprentissage :
-
des accompagnateurs formés dans ce sens et ayant une vraie volonté
d’accompagner les sujets en les amenant à penser et à choisir pour eux- mêmes.
- des méthodes et des outils qui facilitent
l’apprentissage (présentiel, auto-formation assistée, voire auto-formation... )
et qui couvrent l’ensemble des besoins (prise de conscience de ses propres
capacités, développement de l’autonomie, mais aussi transmission de savoirs,
par exemple).
-
et enfin, un contexte réglementaire qui autorise la plus grande souplesse dans les modalités de mise en œuvre des
apprentissages.
Yatchinovsky
Arlette
Les savoirs sont des outils que le stagiaire se donne à
un moment de son histoire parce qu'il
se pose des questions. Pour qu'il ait envie d'apprendre à apprendre, il
faut qu'il se pose des questions et
surtout, il faut qu'il réalise que les
savoirs vont être pour lui un moyen de trouver les réponses aux questions qu'il se pose. Avoir envie d'accéder à ces
savoirs, c'est se donner la possibilité d'apprendre à apprendre, or
apprendre à apprendre, c'est
apprendre à penser. Apprendre à penser, c'est modifier sa relation avec le monde, c'est modifier sa relation avec les
autres et modifier l'image que l'on a de soi. C'est aussi modifier sa façon
d'appréhender les gens et les choses
(les gens en tant que groupes constitués et les individus en tant que personnes).
Pour modifier cette relation, avec le contexte et avec
les individus, il faut commencer à se regarder différemment et penser que l'on
peut rentrer en relation avec le contexte et avec les autres différemment.
C'est, de ce fait, devenir capable d'augmenter sa confiance relationnelle. Les
méthodes cognitives sont les méthodes qui ont pour objectif de donner la possibilité aux individus d'apprendre à
apprendre. Elles donnent vie au savoir auquel les stagiaires peuvent accéder, car elles les intègrent au processus de construction de ces savoirs.
Elles ont pour but de faire en sorte que les savoirs deviennent la propriété de celui qui cherche à y avoir
accès. Le sens que prend cette quête donne du sens à l'apprentissage pour celui
qui apprend. Il lui donne la motivation nécessaire à l'investissement pour
réaliser cet apprentissage. Les méthodes cognitives permettent à l'apprenant
d'accéder à l'intelligence de ce qu'il est puisqu'il accède à l'intelligence de
la situation. Elles lui permettent de trouver le chemin vers la connaissance car il comprend l'intérêt de se
l'approprier.
Patrick
HOUSSIER
Apprendre à
apprendre au regard de la médiation
1/ Le concept :
Selon Alain Moal, le
concept de médiation ne se réfère pas simplement à une attitude
d’empathie » (…) Il s’inscrit dans une approche tripolaire (apprenants,
objet de la formation et formateur) et
même quadripolaire par la prise en compte de l’environnement de la formation.
La médiation se déploie dans le cadre d’une situation-problème que les apprenants
ont à résoudre. Elle est bien centrée sur la tâche à effectuer et le médiateur
vise bien une plus grande efficience de l’appareil cognitif de l’apprenant.
La pédagogie de la médiation
propose une approche constructiviste du savoir. L’apprenant n’est pas un
consommateur de notions mais l’élément dynamique de la construction de son
savoir. Tout le travail pédagogique est donc aménagé de manière à ce qu’il
construise un savoir organisé, structuré à partir de ses expériences.
Les
activités vont donc faire appel à l’utilisation d’aptitudes d’observation, de
repérage, de comparaison et de déductions faites par l’apprenant. «Les
activités font appel à son intelligence et non à sa docilité». Le formateur
doit donc orienter l’attention des apprenants vers la métacognition.
Dans
les activités qui seront mises en place, il devra donner à l’apprenant les
moyens d’agir et afin de rendre son savoir stable, il orientera le travail vers
la prise de conscience de ses propres activités mentales. Ce qui suppose
d’apprendre aux stagiaires à se pencher sur leurs erreurs au moyen d’un
questionnement dynamique. «Si l’apprenant est capable de verbaliser ce qu’il a fait, de retrouver
le chemin qu’il a suivi dans sa tête pour réaliser telle ou telle action et de
mettre en relation les moyens qu’il utilise et les résultats qu’il obtient,
alors il reconnaîtra ailleurs une situation du même ordre et pourra réutiliser
cette démarche».
On visera donc le repérage
de principes de généralisation et la conceptualisation des situations et des
démarches pour préparer le «transfert» des connaissances. On favorisera pour ce
faire l’induction (rassembler les éléments perçus pour en tirer une loi
générale). En résumé, dans toute
activité de médiation, on va s’employer à
-
Travailler à la restauration narcissique des apprenants
-
Fournir aux apprenants toutes les clés de la formation et du contexte dans
lequel cette formation s’inscrit par la pose de repères et de limites
-
Aider les apprenants à mieux comprendre leur fonctionnement mental pour leur
permettre de se doter d’un ensemble d’habitudes de travail performantes par
l’accompagnement dans la gestion de la tâche
2/ Les outils :
A) l’analyse par le
formateur de la situation pédagogique proposée au stagiaire :
*
Analyse de la tâche :
Structure profonde :
Quel est le problème posé ? Quels savoirs, activités mentales, fonctions
cognitives sont requises pour résoudre ce problème ?
Structure de surface :
univers global du contenu, savoirs requis par l’habillage du problème
(ex : vocabulaire), modalités de réponse…
*
Croisement tâche/public : au regard des paramètres d’analyse de la tâche,
quels sont les apprenants susceptibles d’être gênés par tel ou tel point ?
*
Mise en place des stratégies pédagogiques au regard des 2 points
précédents :
-
Travail individuel
-
Médiation entre pairs homogènes (personnes ayant le même niveau mais n’ayant
pas les mêmes difficultés) afin d’utiliser les complémentarités.
-
Médiation entre pairs hétérogènes (un apprenant maîtrisant bien la tâche va
aider les autres et ceci va lui permettre de structurer ses connaissances)
-
Médiation de tutelle (le formateur intervient directement sur le groupe)
Ces différentes stratégies
étant menées de front en constituant des petits groupes et permettant de
dispenser une pédagogie différenciée.
B/ Le repérage des
difficultés fonctionnelles (repérage des difficultés pour lesquelles
l’intelligence de la personne n’est pas en cause mais qui vont parasiter la
résolution du problème (Ex : comportement exploratoire impulsif et non
planifié cf. liste des fonctions cognitives de M. Moal d’après Feuerstein) .
C/ Les 12 critères de
médiation de Feuerstein et les 6 fonctions d’étayage de Bruner
qui visent :
-
La restauration narcissique de l’apprenant.
-
La pose de repères et de limites.
-
L’accompagnement dans la gestion de la tâche.
Jean Vanderspelden
Apprendre à
Apprendre relève essentiellement d’une stratégie, mais aussi d’outils et
de ressources adéquates secondairement, d’accompagnement de l’apprenant
placé volontairement dans un contexte d’apprentissage ouvert. Dans cette
nouvelle posture négociée, l’apprenant est amené progressivement, d’une part à
prendre conscience, par des mises en situation variées, individuelles et
collectives, de sa responsabilité originale et entière dans l’acte d’apprendre
et, d’autre part, à acquérir de nouvelles compétences transversales pour
optimiser ses capacités d’auto-apprentissage sur des champs de connaissances,
académiques ou non, et indépendamment des contenus et au delà de la manière de
les exposer ou de les transmettre.
Apprendre à
Apprendre repose sur la volonté d’améliorer les apprentissages de tout individu
en mobilisant, non seulement ses capacités cognitives (qui concernent les
capacités d’intégration de connaissances - cf le Grand Robert), mais aussi et
surtout ses capacités conatives (qui renvoient à l’idée d’effort pour
l’impulsion de l‘acte d’apprendre - cf le Grand Robert). Les équipes
pédagogiques s’intéressent alors moins au contenu et à la manière dont il est
transmis qu’aux conditions évolutives dans lequel ce contenu est perçu,
approprié et re-construit par l’apprenant, dans une autonomie croissante.
3.4) Mots-clés ou incontournables sur «apprendre à apprendre»
-
Prise de conscience de la
manière d’apprendre propre à chaque individu. Travail sur la reconnaissance.
Changement dans le rapport au savoir et dans ses rapports aux autres
-
Développer ses capacités
cognitives : résolution de problème et traitement de l’information :
prendre des notes, résumer, rendre compte, partager et formaliser.
-
Développer ses capacités
conatives : gérer ses efforts, son implication, ses émotions, son temps, sa
mémoire, sa motivation pour entretenir, renforcer ou ré-activer le désir
d’apprendre.
-
Explorer, innover, chercher,
découvrir, créer et entreprendre pour se former.
-
Prise en compte de son projet
dans son environnement et dans sa relation aux autres.
3.5) Les résonances d’Apprendre à
apprendre
5.1)
apprendre à ré-apprendre
Réactivité des capacités
d’apprentissage après avoir quitté l’école, le collège, le lycée ou
l’université depuis de longues années pour lever des blocages ou de
difficultés.
5.2)
ré-apprendre à apprendre
Repartir sur de nouvelles bases, en
apprenant autrement, souvent après un vécu d’échec scolaire fort, à partir d’un
projet personnel et des circonstances personnelles ou professionnelles
nouvelles et favorables.
5.3)
apprendre à collaborer
Partir du postulat que l’on apprend
pas seul, comme on ne produit pas seul. Installer la formation dans une logique
sociale et relationnelle
5.4)
apprendre à s’auto-former
Se mettre dans une posture nouvelle
pour devenir acteur de sa formation et bénéficier d’un accompagnement évolutif
pour renforcer ses capacités d’autonomie et d’initiative dans l’apprentissage.
5.5)
apprendre à se former à distance
Optimiser les conditions
d’apprentissage compatibles avec ses disponibilités en terme de temps et de
déplacement.
3.6) «Apprendre à apprendre» et
les outils multimédias
Cet état des lieux montre la place
relativement faible ou marginale des outils multimédias dans le champ de
l’apprendre à apprendre, à deux exceptions notables près :
- le site Internet «Apprendre,
comment ça marche ?» mis en place par la Cité des Sciences et de
l’Industrie (voir plus haut). Cette ressource en ligne constitue une mine
d’informations et d’activités accessibles à tous, aussi bien apprenants
qu’appreneurs pour un travail d’auto-réflexion sur sa capacité d’apprendre.
-
les «Ateliers ARL Informatisés»,
les «Ateliers Espace» et les «Ateliers EVAL II» de Jonas
Formation qui s’inscrivent totalement dans le champ de l’éducabilité
cognitive. Cependant, ces trois outils
ne sont plus aujourd’hui commercialisés ou en voie d’extension, faute de
version actualisée !
Cependant, plusieurs ressources
repérées, en particulier dans la Boite à Outils Multimédias, peuvent conforter,
à des niveaux différents et pour des publics adultes faiblement qualifiés, des
approches de types «apprendre à apprendre» en proposant des activités pour
l’apprenant de type résolution de problèmes «ID-Panne» de Jériko,
analyse de cas «Le garage» de Savoirs Interactifs, approche simulation «CUBE
4» de Chrysis, travail sur la logique «C.Logique» de TNT, sur les
tests «Test de QI» de MicroAPP, ou sur la mémoire «Entraînez votre
mémoire» de Stim gnosia. La base de ressource Algora confirme, en partie,
la disposition de ces ressources et apporte un complément sur la logique
«Histoire de vie» et la logique «Développement personnel» avec, en particulier,
les outils vidéos dont la collection «Né pour …. ». Ces ressources
constituent des éléments intéressants pour des actions de formation de
formateurs. On peut citer les outils démarches comme «Les arbres de
connaissance» de Trivium ou «Tam-Tam» de Juste-a-Temps.
Au delà des ressources informatisées
commercialisées, d’autres outils informatisés peuvent venir enrichir des
approches basées sur la pédagogie de la production et la pédagogie de
l’échange : «apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre» (voir les
collecticiels).
Aucune de ces ressources multimédias
existantes ou aucune ressource en cours de développement, même celles intégrant
les dernières avancées couplées de l’Intelligence Artificielle et
des neuro-sciences, ne pourra à elle seule, donner la dimension visée d’«Apprendre à apprendre». L’approche démarche
prime sur l’approche outil. En revanche, cet état des lieux prouve :
- qu’il existe des ressources et,
qu’elles méritent, peut être, d’être mieux connues pour être plus ou mieux utilisées,
- qu’il existe des ressources et,
que certaines d’entre-elles mériteraient, peut être, une actualisation et
qu’elles constituent un apport important à prendre en considération avant
tout projet de création de ressources multimédias nouvelles.
IV) Le questionnaire
Quel
formateur, dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas été confronté à la
difficulté de ses stagiaires, ou de ses apprenants, face à un nouvel
apprentissage. Notre projet s’inscrit dans le cadre du programme européen Equal
et vise à aider les formateurs à mieux répondre à cette difficulté. Ainsi, nous
avons l’ambition de bâtir une «méthodologie» pour faciliter la mise en œuvre
d’une approche de type «apprendre à apprendre». Pour y parvenir, nous avons
besoin de votre expérience et, de ce fait, nous sollicitons votre participation.
-
Dans un premier temps, nous mettons à votre disposition un état des lieux
sur la question de «l’apprendre à apprendre» avec un premier recensement
non exhaustif des territoires, des pratiques, des méthodes et des outils
existants (voir site http://geforme93.forpro-creteil.org/).
-
Puis, nous lançons une enquête légère (voir questionnaire en dix points
ci-contre) pour savoir si vous connaissez, appréciez et utilisez, ces méthodes
ou ces outils et aussi, dans le but d’identifier le type de problèmes que vous
rencontrez et la façon dont chacun d’entre-nous s’y prend pour les résoudre.
Avec l’ensemble des informations recueillies, dont nous vous ferons une
restitution, nous commencerons à élaborer des pistes de réponses.
- En fin de questionnaire, vous pouvez indiquer vos
coordonnées de telle manière que nous puissions vous associer dans la
poursuite de cette action pour bâtir cette «une méthodologie», ou cette «une
boite à outils ou de pratiques» qui aident à répondre à cette problématique en
tenant compte des besoins des apprenants.
Merci de votre contribution
Définitions de référence (extrait de l’état des lieux)
Définition
1 : L’éducabilité cognitive est l’ensemble des pratiques, des techniques qui ont
pour objet explicite et principal de développer l’efficience et
l’autonomisation des apprentissages en réactivant de façon systématique les
procédures de pensée, les structures mentales dont la personne dispose et
dont elle prend conscience. D’après apprendre peut-il s’apprendre ?
Les Cahiers Pédagogiques
N°280
Définition 2 : La formation sur mesure ou «Apprendre à apprendre»
: s’outiller pour faciliter l’apprentissage, c’est-à-dire connaître ses forces et ses faiblesses et, partant,
celles des autres, identifier ses forces et ses faiblesses en période
d’apprentissage; définir les besoins qui en découlent; anticiper les moyens
d’action pour apprendre ; prendre en mains son propre développement,
rechercher les occasions d’apprentissage et profiter de toutes les occasions
possibles pour compléter et enrichir son apprentissage.
Service formation de l’Université de
Montréal.
Identification
- Vous êtes :
p formateur
p coordonnateur
p responsable de formation
p autre, précisez :
- Vous travaillez principalement :
p dans un centre de formation contre l’illettrisme
p dans un GRETA
p dans un APP
p dans un centre de l’ACEREP
p dans un centre de l’ARRCO
p dans un autre centre de formation, précisez :
p dans un autre centre de formation de formateurs, précisez :
p en entreprise
p autre, précisez :
1er
partie : apprendre à apprendre, en général
1) D’une manière générale, pensez-vous que la question ou les pratiques
de «l’apprendre à apprendre» ?
1.1) sont aujourd’hui importantes
p Tout à fait d’accord p Assez d’accord p Pas d’accord du tout p Sans réponse
1.2) concernent plutôt les adultes peu qualifiés
pTout à fait d’accord p Assez d’accord p Pas d’accord du tout p Sans réponse
1.3) sont à priori faciles à mettre en oeuvre
p Tout à fait d’accord p Assez d’accord p Pas d’accord du tout p Sans réponse
1.4)
que les formateurs, en général, sont prêts à la ou les mettre en place
p Tout à fait d’accord p Assez d’accord p Pas d’accord du tout p Sans réponse
2) Dans votre organisme de formation, des approches ou des pratiques de
type «apprendre à apprendre», en général, sont-elles aujourd’hui mises en
œuvre ?
p oui p non p
sans réponse
2.1) si non :
p non, mais elles l’ont été p non, mais c’est en projet p non, mais ce n’est pas prévu
2.2) si oui, préférentiellement avec des adultes :
p
de niveaux VI p
de niveaux V p
de niveaux IV et +
2.3) si oui, de manière :
p
généralisée p
selon les publics ou les formateurs p ciblée p marginalisée
3) Dans votre organisme
de formation, quand vous estimez que les apprenants ne peuvent se détacher de
leurs problèmes personnels, les méthodes "apprendre à apprendre" vous
apparaissent-elles comme une solution ?
p oui p non p
sans réponse
3.1) si oui, voir question 5
3.2) si non, que faites- vous ? :
4) Dans votre organisme
de formation, si les apprenants n'ont pas (encore) assez confiance en leur
capacité d'apprendre directement des contenus, "apprendre à
apprendre" est-il selon vous une réponse à leurs difficultés.
p oui p non p
sans réponse
4.1) si oui, voir question 5
4.2) si non, que faites- vous ? :
5) De votre point de
vue, les approches de type «apprendre à apprendre», répondent plutôt à :
5.1)
une logique de remédiation cognitive (éducabilité cognitive)
p Tout à fait d’accord p Assez d’accord p Pas d’accord du tout p Sans réponse
5.2)
une logique d’accompagnement
- par un travail de reconnaissance (travail sur l’histoire de vie)
p Tout à fait d’accord p Assez d’accord p Pas d’accord du tout p Sans réponse
- par un travail de mise en confiance
(aide méthodologique
sur l’activité de l’apprenant)
p Tout à fait d’accord p Assez d’accord p Pas d’accord du tout p Sans réponse
5.3) une autre logique :
Précisez :
6) Selon votre point
de vue, «Apprendre à apprendre», résonne plutôt avec
6.1)
apprendre à ré-apprendre p oui p non p les deux p Sans rép.
6.2)
ré-apprendre à apprendre p oui p non p les deux p Sans rép.
6.3)
apprendre à collaborer p oui p non p les deux p Sans rép.
6.4)
apprendre à s’auto-former p oui p non p les deux p Sans rép.
6.5)
apprendre à se former à distance p oui p non p les deux p Sans rép.
Autre, précisez :
7) Parmi la liste de méthodes ou d’outils qui relèvent des
approches ou des pratiques «Apprendre à apprendre», quels sont ceux que vous
connaissez, que vous pratiquez ou pour lesquels vous-même ou votre organisme
ont des compétences particulières
Pour avoir plus d’informations sur ces démarches ou ces
outils du domaine de l’Apprendre à Apprendre, vous pouvez consulter un état des
lieux sur cette question Voir site : http://geforme93.forpro-creteil.org/
|
Nom de la démarche ou outil
«apprendre à apprendre» |
Entendu parlé |
Connu |
Pratiqué |
Expertise acquise |
|
P E I Programme d’Enrichissement Instrumental |
|
|
|
|
|
P N L
Programme Neuro Linguistique |
|
|
|
|
|
La Gestion Mentale |
|
|
|
|
|
L’Analyse Transactionnelle |
|
|
|
|
|
Autres,
à compléter : |
|
|
|
|
|
Les ARL Ateliers de Raisonnement Logique |
|
|
|
|
|
ACTIVILOG |
|
|
|
|
|
AXIOS |
|
|
|
|
|
Les cubes de Mialet |
|
|
|
|
|
ORPHEE |
|
|
|
|
|
TANAGRA |
|
|
|
|
|
Autres,
à compléter : |
|
|
|
|
|
Site Internet CSI : apprendre, comment çà
marche ? |
|
|
|
|
|
Le logiciel : C.Logique
– TNT |
|
|
|
|
|
Le logiciel : ID-Panne
– TNT |
|
|
|
|
|
Le logiciel : Sacrées
Machines – TNT |
|
|
|
|
|
Le logiciel : Atelier
Espace - Jonas & TNT |
|
|
|
|
|
Le logiciel : Eval
II – Jonas & TNT |
|
|
|
|
|
Le logiciel : Entraînez
votre mémoire - Hap
Ne |
|
|
|
|
|
La collection VHS « Né
pour …. » |
|
|
|
|
|
Autres,
à compléter : |
|
|
|
|
* à compléter :
7.1 Si vous n’utilisez pas une méthode ou un outil identifiés, comment prenez-vous en compte la
problématique Apprendre à Apprendre ?
8) Parmi la liste des personnes qui se sont intéressées aux approches
ou aux pratiques «apprendre à apprendre», quelles sont celles dont vous
avez déjà entendu parlé, que vous connaissez, dont vous avez déjà lu les
livres, ou que vous avez rencontrées au cours de colloque ou de
formation ?
Pour avoir plus d’informations sur ces démarches ou ces
outils du domaine de l’Apprendre à Apprendre, vous pouvez consulter un état des
lieux sur cette question Voir site : http://geforme93.forpro-creteil.org/
|
Nom de la démarche ou outil
«apprendre à apprendre» |
Entendu parlé |
Connu |
Lu |
Rencontré |
|
Berbaum Jean |
|
|
|
|
|
Bruner |
|
|
|
|
|
Carré Philippe |
|
|
|
|
|
De la Garanderie Antoine |
|
|
|
|
|
Dericke Alain |
|
|
|
|
|
Feurstein Reuten |
|
|
|
|
|
Giordan André |
|
|
|
|
|
Goleman Daniel |
|
|
|
|
|
Higelé |
|
|
|
|
|
Hommage Gérard |
|
|
|
|
|
Huteau Michel |
|
|
|
|
|
Jacquard Albert |
|
|
|
|
|
Mérieu Philippe |
|
|
|
|
|
Moal Alain |
|
|
|
|
|
Perreti André |
|
|
|
|
|
Piaget Jean |
|
|
|
|
|
Sorel Maryvonne |
|
|
|
|
|
Vygotsky |
|
|
|
|
|
Autres,
à compléter : |
|
|
|
|
* à compléter :
9)
A votre avis, faut-il des compétences particulières pour que les
formateurs mettent en oeuvre des outils ou des démarches «Apprendre à
Apprendre» ?
p oui p non p Sans réponse
9.1) Si, oui précisez quels types de compétences ?
2ème
partie : apprendre à apprendre & le multimédia
10) Selon vous, sur cette
question de «Apprendre à apprendre», faudrait-il créer de nouveaux
outils ou ressources ?
p oui p non p Sans réponse
si
oui
10.1) l’approche ressource «outils» en direction
des apprenants, vous paraît-elle pertinente ?
p oui p non p Sans réponse
Si oui, sur quel type de support faudrait-il les développer ?
p Papier crayon p Jeu plateau p Jeu réseau p Audiovisuel p Cédérom p Internet
10.2) l’approche ressource «démarche» en
direction plutôt des formateurs, vous paraît-elle pertinente ?
p oui p non p Sans réponse
Si oui, sur quel type de support faudrait-il les développer ?
0
p Papier crayon p Jeu plateau p Jeu réseau p Audiovisuel p Cédérom p Internet
11) Concernant la veille
documentaire sur les ressources multimédias dans le champ de l’ «Apprendre
à apprendre», quelles sources mobilisez-vous ?
|
Référence |
Entendu parlé |
Connu |
Utilisé ponctuellement |
Utilisé régulièrement |
|
La Boîte à Outils
Multimédias – MIP+ |
|
|
|
|
|
La Base Ressources
– Algora |
|
|
|
|
|
Une base d’un Centre de
Ressource Régional OREP, CRRIP, autres |
|
|
|
|
|
Via un moteur de recherche
Internet Copernic,
Google ou autres… |
|
|
|
|
|
Autres à préciser : |
|
|
|
|
Remarques ou informations
autres :
- Souhaiteriez-vous être
associé à la suite de ce projet EQUAL ?
p en recevant de l’information ?
p en participant à un groupe de travail ?
p en participant à un groupe de
production ?
p autre, précisez :
- Vos coordonnées (facultatif mais apprécié) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Email : Tél :
Merci de retourner ce questionnaire à :
Céline Jacquemard – Algora - 18/26 rue Goubet – 75959 Paris cedex 19 –
Tél : 01.48.03.90.00. & Fax : 01.48.03.90.21 celine.jacquemard@algora.org
